 En collaboration avec des experts de l’Université du Montana, des chercheurs ont analysé les images de sept espèces identifiées : écureuils, renards gris et roux, opossums de Virginie, lapins à queue blanche, marmottes et tamias de l’Est, qui étaient plus fréquemment observées dans les cours des immeubles que dans les forêts. De plus, des animaux tels que le cerf de Virginie et des ratons laveurs étaient également plus présents dans les forêts péri-urbaines que dans les forêts rurales. « Cela a fondamentalement confirmé que certaines espèces sont plus abondantes en ville » a déclaré le professeur Kays, agrégé à NC State et directeur du laboratoire de biodiversité et d’observation de la Terre au NC Museum of Natural Resources, qui ajoute : « Ils utilisent un peu les jardins, un peu les tas de broussailles, un peu les plans d’eau, mais l’alimentation a l’influence la plus directe sur l’activité de ces animaux ». Confirmant la création d’une chaine alimentaire « urbaine », les scientifiques ont reconstitué son cheminement, apparemment innocent. « On commence par donner quelques graines aux petits passereaux. Ainsi nourris et protégés, ils prolifèrent, mais attirent dans leur sillage leurs prédateurs habituels, pour qui, dans ce milieu artificialisé, tout est facilité. Problème également chez les humains, pour qui le développement est généralement associé à une perte de biodiversité. Les scientifiques ont constaté qu’ils trouvaient, dans leur comportement « nourricier », une forme de déculpabilisation. « Cela montre que les décisions individuelles des habitants ont un impact important sur la faune, mais soulève cette question : est-ce une bonne ou mauvaise chose. Quand vous voyez cette recommandation - ne nourrissez pas les ours -, il ne s’agit pas seulement de supprimer les apports directs de nourriture, mais également de ne pas en distribuer aux animaux qui sont leurs proies habituelles. C’est cette limite qui est difficile à trouver » conclut le professeur Kays.
En collaboration avec des experts de l’Université du Montana, des chercheurs ont analysé les images de sept espèces identifiées : écureuils, renards gris et roux, opossums de Virginie, lapins à queue blanche, marmottes et tamias de l’Est, qui étaient plus fréquemment observées dans les cours des immeubles que dans les forêts. De plus, des animaux tels que le cerf de Virginie et des ratons laveurs étaient également plus présents dans les forêts péri-urbaines que dans les forêts rurales. « Cela a fondamentalement confirmé que certaines espèces sont plus abondantes en ville » a déclaré le professeur Kays, agrégé à NC State et directeur du laboratoire de biodiversité et d’observation de la Terre au NC Museum of Natural Resources, qui ajoute : « Ils utilisent un peu les jardins, un peu les tas de broussailles, un peu les plans d’eau, mais l’alimentation a l’influence la plus directe sur l’activité de ces animaux ». Confirmant la création d’une chaine alimentaire « urbaine », les scientifiques ont reconstitué son cheminement, apparemment innocent. « On commence par donner quelques graines aux petits passereaux. Ainsi nourris et protégés, ils prolifèrent, mais attirent dans leur sillage leurs prédateurs habituels, pour qui, dans ce milieu artificialisé, tout est facilité. Problème également chez les humains, pour qui le développement est généralement associé à une perte de biodiversité. Les scientifiques ont constaté qu’ils trouvaient, dans leur comportement « nourricier », une forme de déculpabilisation. « Cela montre que les décisions individuelles des habitants ont un impact important sur la faune, mais soulève cette question : est-ce une bonne ou mauvaise chose. Quand vous voyez cette recommandation - ne nourrissez pas les ours -, il ne s’agit pas seulement de supprimer les apports directs de nourriture, mais également de ne pas en distribuer aux animaux qui sont leurs proies habituelles. C’est cette limite qui est difficile à trouver » conclut le professeur Kays.
Quelques brèves de chez nous et... d'ailleurs

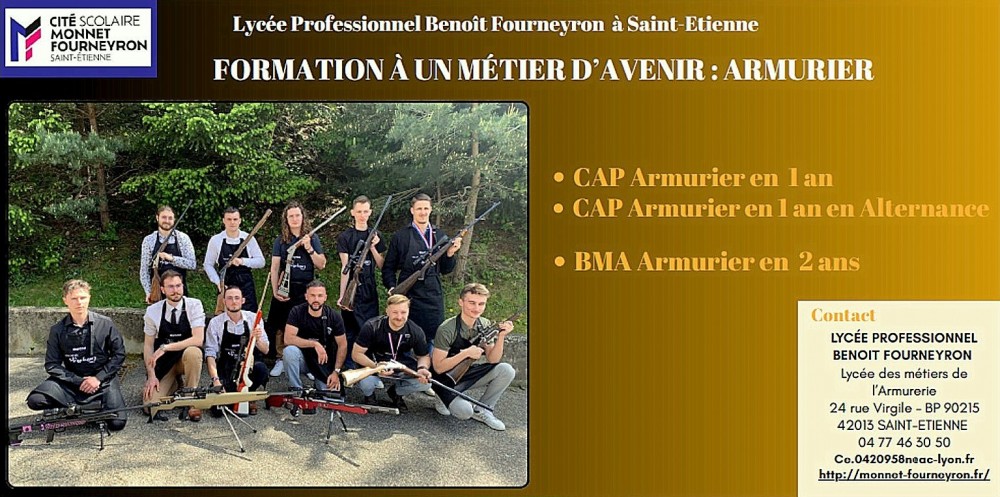
 Le réseau FRENE est né d’une démarche soutenue par un collectif d'acteurs en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 2008. On y trouve l’ONF, la coopérative Coforêt, les communes forestières, Fransylva, le CNPF, la FRAPNA, la LPO, Forêts sauvages, le ministère chargé de l’environnement (DREAL) et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Acronyme de « Forêt en Evolution Naturelle », ce réseau s’étend maintenant à la région Occitanie pour déployer des forêts en libre évolution, par un choix volontaire des propriétaires publics ou privés.
Le réseau FRENE est né d’une démarche soutenue par un collectif d'acteurs en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 2008. On y trouve l’ONF, la coopérative Coforêt, les communes forestières, Fransylva, le CNPF, la FRAPNA, la LPO, Forêts sauvages, le ministère chargé de l’environnement (DREAL) et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Acronyme de « Forêt en Evolution Naturelle », ce réseau s’étend maintenant à la région Occitanie pour déployer des forêts en libre évolution, par un choix volontaire des propriétaires publics ou privés.  Une volonté qui s’inscrit dans la convention cadre nationale de partenariat ONF-FNE. Après le webinaire national organisé par l’ONF et FNE en juin 2022 pour lancer cette démarche, l'association « NeO » (Nature en Occitanie) était mandatée pour initier le déploiement du réseau dans cette région, et, le 9 novembre 2023, une réunion d’information des acteurs locaux potentiellement intéressés était organisée dans les locaux de la DREAL Occitanie, à Toulouse. L’ONF et NeO y avaient convié le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) d’Occitanie, le Conservatoire botanique national Pyrénées et Midi-Pyrénées, les Parcs nationaux, les Parcs naturels régionaux, des instances étatiques (DREAL, DRAAF, région Occitanie) et des représentants des différents propriétaires forestiers (CNPF, URCofor). Tous ayant manifesté leur intérêt pour le projet, il s’agit maintenant de mettre en place et de développer la trame de forêts en libre évolution. Actuellement, la région Occitanie est riche de 1860 hectares de réserves biologiques intégrales, et a en projet 1748 ha de réserves, ainsi que 8526 ha d'îlots de sénescence (zones forestières laissées en vieillissement naturel). De plus, le nouveau classement possible des surfaces en « hors sylviculture en libre évolution » (HSN-LE) va permettre d’inscrire les forêts publiques en libre évolution durable, au rythme des révisions des documents d’aménagement forestier.
Une volonté qui s’inscrit dans la convention cadre nationale de partenariat ONF-FNE. Après le webinaire national organisé par l’ONF et FNE en juin 2022 pour lancer cette démarche, l'association « NeO » (Nature en Occitanie) était mandatée pour initier le déploiement du réseau dans cette région, et, le 9 novembre 2023, une réunion d’information des acteurs locaux potentiellement intéressés était organisée dans les locaux de la DREAL Occitanie, à Toulouse. L’ONF et NeO y avaient convié le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) d’Occitanie, le Conservatoire botanique national Pyrénées et Midi-Pyrénées, les Parcs nationaux, les Parcs naturels régionaux, des instances étatiques (DREAL, DRAAF, région Occitanie) et des représentants des différents propriétaires forestiers (CNPF, URCofor). Tous ayant manifesté leur intérêt pour le projet, il s’agit maintenant de mettre en place et de développer la trame de forêts en libre évolution. Actuellement, la région Occitanie est riche de 1860 hectares de réserves biologiques intégrales, et a en projet 1748 ha de réserves, ainsi que 8526 ha d'îlots de sénescence (zones forestières laissées en vieillissement naturel). De plus, le nouveau classement possible des surfaces en « hors sylviculture en libre évolution » (HSN-LE) va permettre d’inscrire les forêts publiques en libre évolution durable, au rythme des révisions des documents d’aménagement forestier. Si vous avez encore la chance d’avoir une population de perdrix, vous avez sans doute remarqué un regain d’activité. Les couples vont se former et cela ne se fait pas toujours calmement. Il n'est pas facile de faire le bon choix, d’autant plus que leurs hormones les titillent. Les oiseaux dansent et sautent sur place, se poursuivent, se provoquent et se battent. Pourtant, ce comportement ne concerne pas que les coqs. Les poules jouent également leur partition, faisant et défaisant aussi vite le couple formé la veille, et quand un nouveau venu se présente, les joutes recommencent. Il en sera ainsi quasiment jusqu’à fin avril, début de la période de ponte. La poule déposera alors ses œufs dans un nid situé à même le sol, dans une dépression d’une vingtaine de centimètres de diamètre, garnie de végétaux et de plumes. C’est la hauteur du couvert environnant qui détermine le site du nid, plutôt que la nature de la végétation. Les zones incultes (friches et talus herbeux) sont préférées, et abritent près de 60% des nids. Ensuite, on les trouvera dans les cultures fourragères et les zones céréalières où les nids sont toujours situés en bordure, dans une bande n’excédant pas une dizaine de mètres. De 15 à 20 œufs seront couvés assidûment pendant 24 jours par la poule, laissant le coq, que les joies de l'incubation ne contraignent pas, assurer la défense du territoire en étant bien visible et en lançant ses « pir-ouitt ». Le déclin de l’oiseau est dramatique dans presque toutes les régions, et les raisons sont encore mal connues. Il est difficile de mettre en avant un facteur plus qu’un autre, mais la prédation et les mauvaises conditions météorologiques sont les causes les plus sévères. S'il pleut ou s'il fait froid au moment des éclosions, les jeunes oiseaux souffrent et les pertes sont considérables. L’espèce étant inféodée aux milieux agricoles, c’est le réseau Agrifaune qui travaille avec les agriculteurs et les FDC pour tenter de redonner un peu de vigueur aux populations résiduelles.
Si vous avez encore la chance d’avoir une population de perdrix, vous avez sans doute remarqué un regain d’activité. Les couples vont se former et cela ne se fait pas toujours calmement. Il n'est pas facile de faire le bon choix, d’autant plus que leurs hormones les titillent. Les oiseaux dansent et sautent sur place, se poursuivent, se provoquent et se battent. Pourtant, ce comportement ne concerne pas que les coqs. Les poules jouent également leur partition, faisant et défaisant aussi vite le couple formé la veille, et quand un nouveau venu se présente, les joutes recommencent. Il en sera ainsi quasiment jusqu’à fin avril, début de la période de ponte. La poule déposera alors ses œufs dans un nid situé à même le sol, dans une dépression d’une vingtaine de centimètres de diamètre, garnie de végétaux et de plumes. C’est la hauteur du couvert environnant qui détermine le site du nid, plutôt que la nature de la végétation. Les zones incultes (friches et talus herbeux) sont préférées, et abritent près de 60% des nids. Ensuite, on les trouvera dans les cultures fourragères et les zones céréalières où les nids sont toujours situés en bordure, dans une bande n’excédant pas une dizaine de mètres. De 15 à 20 œufs seront couvés assidûment pendant 24 jours par la poule, laissant le coq, que les joies de l'incubation ne contraignent pas, assurer la défense du territoire en étant bien visible et en lançant ses « pir-ouitt ». Le déclin de l’oiseau est dramatique dans presque toutes les régions, et les raisons sont encore mal connues. Il est difficile de mettre en avant un facteur plus qu’un autre, mais la prédation et les mauvaises conditions météorologiques sont les causes les plus sévères. S'il pleut ou s'il fait froid au moment des éclosions, les jeunes oiseaux souffrent et les pertes sont considérables. L’espèce étant inféodée aux milieux agricoles, c’est le réseau Agrifaune qui travaille avec les agriculteurs et les FDC pour tenter de redonner un peu de vigueur aux populations résiduelles. Un homme est décédé, fin janvier, dans l’Etat américain de l’Alaska, des suites du virus Alaskapox, découvert récemment, rapportent le « Guardian ». L’homme, originaire de la péninsule de Kenai, avait été hospitalisé en novembre, ont annoncé les autorités sanitaires de l’Etat. Il s’agit du premier décès connu, causé par ce virus, baptisé « AKPV », puisque lié à la variole. C’est donc un orthopoxvirus, identifié pour la première fois chez une femme adulte vivant près de Fairbanks en 2015, renseigne le département de santé d’Alaska. Les symptômes comprennent des éruptions cutanées, des douleurs articulaires ou musculaires, et un gonflement des ganglions lymphatiques. Depuis 2015, seuls 6 cas ont été détectés dans l’Etat d’Alaska. Leur point commun : les patients touchés vivaient tous dans la région de Fairbanks, à plusieurs centaines de kilomètres de la péninsule de Kenai. L’homme décédé, dont on ne connaît pas l’âge exact, était atteint d’un cancer. Son système immunitaire était donc déjà affaibli, ce qui pourrait avoir contribué à aggraver son état, selon les autorités sanitaires. « Il résidait seul dans une zone boisée et n’avait signalé aucun voyage récent, ni contact étroit avec un voyage récent, une maladie ou des lésions similaires », peut-on lire dans le bulletin de santé. D’après les chercheurs, le virus pourrait se transmettre d’animaux à humains, des tests ayant révélés des preuves d’infection chez plusieurs espèces de petits mammifères de la région de Fairbanks (campagnols à dos roux et musaraignes), dans le centre de l’Etat.
Un homme est décédé, fin janvier, dans l’Etat américain de l’Alaska, des suites du virus Alaskapox, découvert récemment, rapportent le « Guardian ». L’homme, originaire de la péninsule de Kenai, avait été hospitalisé en novembre, ont annoncé les autorités sanitaires de l’Etat. Il s’agit du premier décès connu, causé par ce virus, baptisé « AKPV », puisque lié à la variole. C’est donc un orthopoxvirus, identifié pour la première fois chez une femme adulte vivant près de Fairbanks en 2015, renseigne le département de santé d’Alaska. Les symptômes comprennent des éruptions cutanées, des douleurs articulaires ou musculaires, et un gonflement des ganglions lymphatiques. Depuis 2015, seuls 6 cas ont été détectés dans l’Etat d’Alaska. Leur point commun : les patients touchés vivaient tous dans la région de Fairbanks, à plusieurs centaines de kilomètres de la péninsule de Kenai. L’homme décédé, dont on ne connaît pas l’âge exact, était atteint d’un cancer. Son système immunitaire était donc déjà affaibli, ce qui pourrait avoir contribué à aggraver son état, selon les autorités sanitaires. « Il résidait seul dans une zone boisée et n’avait signalé aucun voyage récent, ni contact étroit avec un voyage récent, une maladie ou des lésions similaires », peut-on lire dans le bulletin de santé. D’après les chercheurs, le virus pourrait se transmettre d’animaux à humains, des tests ayant révélés des preuves d’infection chez plusieurs espèces de petits mammifères de la région de Fairbanks (campagnols à dos roux et musaraignes), dans le centre de l’Etat. Alors que le Salon de l’Agriculture doit ouvrir ses portes samedi prochain, les syndicats agricoles maintiennent la pression. Pourtant, derrière les revendications, les responsables voudraient bien que les promesses du gouvernement soient tenues, et que la sérénité revienne pour la grande fête annuelle de l’agriculture. Le bras de fer va donc durer encore deux ou trois jours. Que lâchera le Premier ministre ? A ce jour, nul ne le sait, car à ce jeu il ne faut pas de perdants. On va donc s’atteler à « sauver la face », ce qui n’empêche pas la Commission européenne de poursuivre les négociations sur le « Mercosur » (traité de libre-échange entre l’Union européenne et des pays d’Amérique du Sud : Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, Vénézuela (suspendu en 2017). La Colombie, le Chili, le Pérou, la Bolivie et l'Equateur, le Guyana et le Suriname ayant le statut de membres associés), malgré l’engagement du Président de la République qui avait promis leur arrêt. En jeu, l’importation de 180 000 tonnes de sucre, 60 000 tonnes de riz, 100 000 tonnes de volailles, 99 000 tonnes de bœuf, 25 000 tonnes de viande de porcine… en échange de garanties d’approvisionnement de minerais, d’exportation de voitures, etc… L’accord une fois conclu par la Commission devra encore être approuvé par le Parlement européen et par les 27 pays membres, à la majorité qualifiée. Certes cela ne pourra pas se faire avant les élections européennes de juin prochain, mais il est évident qu’il sera difficile de revenir sur des accords passés. Rien n’est donc joué, et même si le Salon de l'Agriculture se passe bien, il est fort probable que les agriculteurs remettront le couvert après la manifestation.
Alors que le Salon de l’Agriculture doit ouvrir ses portes samedi prochain, les syndicats agricoles maintiennent la pression. Pourtant, derrière les revendications, les responsables voudraient bien que les promesses du gouvernement soient tenues, et que la sérénité revienne pour la grande fête annuelle de l’agriculture. Le bras de fer va donc durer encore deux ou trois jours. Que lâchera le Premier ministre ? A ce jour, nul ne le sait, car à ce jeu il ne faut pas de perdants. On va donc s’atteler à « sauver la face », ce qui n’empêche pas la Commission européenne de poursuivre les négociations sur le « Mercosur » (traité de libre-échange entre l’Union européenne et des pays d’Amérique du Sud : Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, Vénézuela (suspendu en 2017). La Colombie, le Chili, le Pérou, la Bolivie et l'Equateur, le Guyana et le Suriname ayant le statut de membres associés), malgré l’engagement du Président de la République qui avait promis leur arrêt. En jeu, l’importation de 180 000 tonnes de sucre, 60 000 tonnes de riz, 100 000 tonnes de volailles, 99 000 tonnes de bœuf, 25 000 tonnes de viande de porcine… en échange de garanties d’approvisionnement de minerais, d’exportation de voitures, etc… L’accord une fois conclu par la Commission devra encore être approuvé par le Parlement européen et par les 27 pays membres, à la majorité qualifiée. Certes cela ne pourra pas se faire avant les élections européennes de juin prochain, mais il est évident qu’il sera difficile de revenir sur des accords passés. Rien n’est donc joué, et même si le Salon de l'Agriculture se passe bien, il est fort probable que les agriculteurs remettront le couvert après la manifestation. Depuis le début de l’année, le tri des biodéchets a été rendu obligatoire pour tous les ménages français. Cela signifie que les déchets verts ne doivent plus être mis à la poubelle. Alors que des solutions de tri tardent à être mises en place par les communes, de nombreux français se sont tournés vers le compostage. Pratique et écologique, il permet d’obtenir gratuitement un engrais pour les plantes, intérieures comme extérieures. Mais attention, car un ingrédient a été officiellement prohibé par les autorités. L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a récemment publié un avis soulignant le danger d’un élément fréquemment ajouté par de nombreux habitants à leur tas de compost. Ce sont les plastiques prétendument « biodégradables » qui, en réalité, ne se décomposent pas entièrement. « Bien que certains produits comme les sachets de thé et les capsules de café soient étiquetés comme compostables, ils ne se dégradent pas totalement dans le sol. Le principal danger est la contamination de vos cultures par des microplastiques, pouvant être consommés à votre insu. Déposer ces plastiques dans le compost, sans autre action n’est donc pas recommandé. Il est essentiel de remuer le compost régulièrement, au moins deux fois par semaine, et de contrôler souvent sa température. Si cette tâche n’est pas réalisable, évitez de mettre ces plastiques dans le compost et optez plutôt pour le tri sélectif, en les jetant dans la poubelle de recyclage » conseille l’Anses qui ajoute également d’autres déchets à proscrire, car ils peuvent entraver la décomposition, apporter de mauvaises odeurs ou encore d’attirer des nuisibles : le charbon issu de barbecue ou de bois ; tout objet contenant du fer ou d’autres métaux ; la litière des chats ; les textiles et chiffons ; les huiles et graisses de cuisine ; la poussière collectée par l’aspirateur ; la viande, le poisson et les produits laitiers.
Depuis le début de l’année, le tri des biodéchets a été rendu obligatoire pour tous les ménages français. Cela signifie que les déchets verts ne doivent plus être mis à la poubelle. Alors que des solutions de tri tardent à être mises en place par les communes, de nombreux français se sont tournés vers le compostage. Pratique et écologique, il permet d’obtenir gratuitement un engrais pour les plantes, intérieures comme extérieures. Mais attention, car un ingrédient a été officiellement prohibé par les autorités. L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a récemment publié un avis soulignant le danger d’un élément fréquemment ajouté par de nombreux habitants à leur tas de compost. Ce sont les plastiques prétendument « biodégradables » qui, en réalité, ne se décomposent pas entièrement. « Bien que certains produits comme les sachets de thé et les capsules de café soient étiquetés comme compostables, ils ne se dégradent pas totalement dans le sol. Le principal danger est la contamination de vos cultures par des microplastiques, pouvant être consommés à votre insu. Déposer ces plastiques dans le compost, sans autre action n’est donc pas recommandé. Il est essentiel de remuer le compost régulièrement, au moins deux fois par semaine, et de contrôler souvent sa température. Si cette tâche n’est pas réalisable, évitez de mettre ces plastiques dans le compost et optez plutôt pour le tri sélectif, en les jetant dans la poubelle de recyclage » conseille l’Anses qui ajoute également d’autres déchets à proscrire, car ils peuvent entraver la décomposition, apporter de mauvaises odeurs ou encore d’attirer des nuisibles : le charbon issu de barbecue ou de bois ; tout objet contenant du fer ou d’autres métaux ; la litière des chats ; les textiles et chiffons ; les huiles et graisses de cuisine ; la poussière collectée par l’aspirateur ; la viande, le poisson et les produits laitiers. - Ardèche
- Ardèche - Aveyron
- Aveyron
 Le climat dans le monde est affecté par le phénomène El Niño et son pendant, La Niña. Ces évènements climatiques trouvent leurs origines dans l’anomalie des températures des eaux de surface du Pacifique équatorial. Sécheresse en Amérique centrale ou en Afrique australe, précipitations intenses sur les côtes du Pérou et de l'Équateur, température moyenne à l'échelle du globe anormalement élevée. Le phénomène El Niño, qui affecte le climat mondial dans son ensemble, impacte également l'activité cyclonique à l'échelle planétaire : certaines zones océaniques enregistrent une activité plus faible que la normale, alors que d'autres, comme le bassin Pacifique, connaissent des cyclones particulièrement dévastateurs. El Niño et La Niña correspondent aux deux phases opposées du phénomène couplé océan/atmosphère appelé ENSO (El Niño Southern Oscillation). À l'origine, l'appellation El Niño a été attribuée par les pêcheurs péruviens à la petite invasion d'eau chaude qui se produit chaque année le long des côtes du Pérou et de l'Équateur, aux environs de Noël, d'où son nom qui, en espagnol, désigne l'enfant Jésus. Depuis juin 2023, El Niño s'est additionné au pouvoir réchauffant des gaz à effet de serre, issu des activités humaines, et a contribué aux nombreux records de chaleur sur Terre. L'intensité d'El Niño, pour 2023, le place à la cinquième position des plus forts depuis 1950…
Le climat dans le monde est affecté par le phénomène El Niño et son pendant, La Niña. Ces évènements climatiques trouvent leurs origines dans l’anomalie des températures des eaux de surface du Pacifique équatorial. Sécheresse en Amérique centrale ou en Afrique australe, précipitations intenses sur les côtes du Pérou et de l'Équateur, température moyenne à l'échelle du globe anormalement élevée. Le phénomène El Niño, qui affecte le climat mondial dans son ensemble, impacte également l'activité cyclonique à l'échelle planétaire : certaines zones océaniques enregistrent une activité plus faible que la normale, alors que d'autres, comme le bassin Pacifique, connaissent des cyclones particulièrement dévastateurs. El Niño et La Niña correspondent aux deux phases opposées du phénomène couplé océan/atmosphère appelé ENSO (El Niño Southern Oscillation). À l'origine, l'appellation El Niño a été attribuée par les pêcheurs péruviens à la petite invasion d'eau chaude qui se produit chaque année le long des côtes du Pérou et de l'Équateur, aux environs de Noël, d'où son nom qui, en espagnol, désigne l'enfant Jésus. Depuis juin 2023, El Niño s'est additionné au pouvoir réchauffant des gaz à effet de serre, issu des activités humaines, et a contribué aux nombreux records de chaleur sur Terre. L'intensité d'El Niño, pour 2023, le place à la cinquième position des plus forts depuis 1950… Après six ans de travaux, le site parisien du Musée national de la Marine a réouvert ses portes, fin 2023. Ses espaces muséographiques ont été entièrement rénovés et repensés pour transmettre le goût de la mer, la conscience des enjeux et des défis qui la traversent, et retracer son histoire. Or, par le bois qu’elle a, de tous temps utilisé, l’histoire de la marine est intimement liée à celle des forestiers, comme ces grands travaux de boisement, réalisés en forêt de Tronçais, initialement propriété des quatorze paroisses environnantes. Cédée en 1327 aux ducs de Bourbon, la forêt de Tronçais devient propriété du pouvoir royal en 1527, année où elle fut confisquée au Connétable de Bourbon, avec l'ensemble de ses terres. En 1670, Colbert, désireux de doter le royaume de France d'une marine puissante a décidé de planter plus d'un million d'hectares d'arbres dont les troncs et les branches, spécialement sélectionnés, doivent fournir à l'industrie navale une matière première de grande qualité. Il fait ainsi rédiger un catalogue reproduisant les pièces spéciales, « les bois tors », dont le but était de présenter les pièces de bois particulières destinées à la charpenterie de marine. Ironie de l’histoire, la forêt de Tronçais n’a fourni que peu de bois pour les charpentes des bateaux. Trop droit et avec des croissances qui ne confèrent pas les qualités requises pour construire les navires, Tronçais fournit surtout du bois d'ébénisterie. En souvenir de ces temps « historiques », L’ONF a accepté de fournir une borne de la forêt domaniale de Tronçais, dite borne Colbert. Elle faisait partie de 1072 bornes installées à la fin du 18ème siècle sur le périmètre externe de la forêt. Le but de ces implantations était d’une part de définir clairement la limite du domaine royal et d’autre part de protéger la forêt des dégradations qu’elle pouvait subir. Sur une carte datant de 1665 (carte des Fleury), la borne Colbert apparaissait en bordure de l’enclave n°66 qui faisait 5,5 arpents selon les mesures de l’époque. Etroitement liée à l’ordonnance de Colbert de 1669, cette borne revêt une importante dimension historique qui a toute sa place au Musée de la Marine au sein d'un parcours repensé comme une invitation au voyage à travers l’histoire, un carrefour d’échanges scientifiques, un lieu de découverte et de sensibilisation aux enjeux maritimes français et internationaux.
Après six ans de travaux, le site parisien du Musée national de la Marine a réouvert ses portes, fin 2023. Ses espaces muséographiques ont été entièrement rénovés et repensés pour transmettre le goût de la mer, la conscience des enjeux et des défis qui la traversent, et retracer son histoire. Or, par le bois qu’elle a, de tous temps utilisé, l’histoire de la marine est intimement liée à celle des forestiers, comme ces grands travaux de boisement, réalisés en forêt de Tronçais, initialement propriété des quatorze paroisses environnantes. Cédée en 1327 aux ducs de Bourbon, la forêt de Tronçais devient propriété du pouvoir royal en 1527, année où elle fut confisquée au Connétable de Bourbon, avec l'ensemble de ses terres. En 1670, Colbert, désireux de doter le royaume de France d'une marine puissante a décidé de planter plus d'un million d'hectares d'arbres dont les troncs et les branches, spécialement sélectionnés, doivent fournir à l'industrie navale une matière première de grande qualité. Il fait ainsi rédiger un catalogue reproduisant les pièces spéciales, « les bois tors », dont le but était de présenter les pièces de bois particulières destinées à la charpenterie de marine. Ironie de l’histoire, la forêt de Tronçais n’a fourni que peu de bois pour les charpentes des bateaux. Trop droit et avec des croissances qui ne confèrent pas les qualités requises pour construire les navires, Tronçais fournit surtout du bois d'ébénisterie. En souvenir de ces temps « historiques », L’ONF a accepté de fournir une borne de la forêt domaniale de Tronçais, dite borne Colbert. Elle faisait partie de 1072 bornes installées à la fin du 18ème siècle sur le périmètre externe de la forêt. Le but de ces implantations était d’une part de définir clairement la limite du domaine royal et d’autre part de protéger la forêt des dégradations qu’elle pouvait subir. Sur une carte datant de 1665 (carte des Fleury), la borne Colbert apparaissait en bordure de l’enclave n°66 qui faisait 5,5 arpents selon les mesures de l’époque. Etroitement liée à l’ordonnance de Colbert de 1669, cette borne revêt une importante dimension historique qui a toute sa place au Musée de la Marine au sein d'un parcours repensé comme une invitation au voyage à travers l’histoire, un carrefour d’échanges scientifiques, un lieu de découverte et de sensibilisation aux enjeux maritimes français et internationaux. Mardi dernier, à Troyes (Aube), a été rendu un dernier hommage à celui que bien des diplômés du « Brevet Grand Gibier » du Grand-Est ont eu comme formateur : Jean-Pierre Devillers. Originaire de Dijon, il a passé une partie de sa carrière professionnelle en Normandie, où il oeuvrait pour la gestion de la forêt et l’approvisionnement de deux scieries. C’est dans cette région qu’il a rencontré Sylviane, qui devint son épouse et lui donna un fils, Julien. De retour dans l’Est, il fit une autre partie de sa carrière chez Dumeste, à la manufacture auboise de sièges, à Bar Sur Aube. Très professionnel et curieux de tout, il connaissait les arbres, les forêts européennes, les entreprises et les marchés. Sa passion pour le monde de la chasse l’a rapproché des grandes forêts, celles qui accueillaient déjà des grands cervidés auxquels il vouait un véritable culte. Il se préoccupait également de nombreux autres massifs forestiers en phase de colonisation par le cerf. Généreux en conseils avisés, il suivait ces populations animales à travers un réseau de photographes, chasseurs, chercheurs de mues et autres passionnés de nature. Jean-Pierre Devillers était un naturaliste chasseur. Il n’aimait pas la médiocrité, et le directeur de chasse qu’il était au « Carrefour de Joinville », un des lots de la forêt domaniale d’Arc en Barrois, donnait toujours des consignes précises au rond de battue. Les cerfs, les hommes et les forêts ont perdu discrètement un Ami, en ce début de février.
Mardi dernier, à Troyes (Aube), a été rendu un dernier hommage à celui que bien des diplômés du « Brevet Grand Gibier » du Grand-Est ont eu comme formateur : Jean-Pierre Devillers. Originaire de Dijon, il a passé une partie de sa carrière professionnelle en Normandie, où il oeuvrait pour la gestion de la forêt et l’approvisionnement de deux scieries. C’est dans cette région qu’il a rencontré Sylviane, qui devint son épouse et lui donna un fils, Julien. De retour dans l’Est, il fit une autre partie de sa carrière chez Dumeste, à la manufacture auboise de sièges, à Bar Sur Aube. Très professionnel et curieux de tout, il connaissait les arbres, les forêts européennes, les entreprises et les marchés. Sa passion pour le monde de la chasse l’a rapproché des grandes forêts, celles qui accueillaient déjà des grands cervidés auxquels il vouait un véritable culte. Il se préoccupait également de nombreux autres massifs forestiers en phase de colonisation par le cerf. Généreux en conseils avisés, il suivait ces populations animales à travers un réseau de photographes, chasseurs, chercheurs de mues et autres passionnés de nature. Jean-Pierre Devillers était un naturaliste chasseur. Il n’aimait pas la médiocrité, et le directeur de chasse qu’il était au « Carrefour de Joinville », un des lots de la forêt domaniale d’Arc en Barrois, donnait toujours des consignes précises au rond de battue. Les cerfs, les hommes et les forêts ont perdu discrètement un Ami, en ce début de février. Un plan d’eau tranquille en milieu arbustif ou roselier peut sédentariser facilement des canards colverts au printemps, surtout si on y aménage des zones de nidification. Les paniers de ponte dissimulent et protègent les nids de la vue et des atteintes des prédateurs terrestres (fouines, putois, renards, hermines) qui fréquentent les rives des étangs. Ils peuvent être placés dans les saules têtards, situés en rive, mais il conviendra de façonner l’emplacement en coupant les branchettes gênantes. Les paniers pourront également être placés sur des radeaux flottants, qui devront coulisser si le niveau de la pièce d’eau est variable, ou dans la végétation arbustive des rives, mais là ils seront plus exposés. L’entrée des paniers de ponte doit toujours être orienté au sud. L’intérieur sera garni d’une couche de foin d’herbe, plus résistant que la paille. Posés en pleine eau, à une dizaine de mètres des rives, les paniers seront fixés à environ 30 centimètres au-dessus de la surface de l’eau, sur quatre piquets croisés…
Un plan d’eau tranquille en milieu arbustif ou roselier peut sédentariser facilement des canards colverts au printemps, surtout si on y aménage des zones de nidification. Les paniers de ponte dissimulent et protègent les nids de la vue et des atteintes des prédateurs terrestres (fouines, putois, renards, hermines) qui fréquentent les rives des étangs. Ils peuvent être placés dans les saules têtards, situés en rive, mais il conviendra de façonner l’emplacement en coupant les branchettes gênantes. Les paniers pourront également être placés sur des radeaux flottants, qui devront coulisser si le niveau de la pièce d’eau est variable, ou dans la végétation arbustive des rives, mais là ils seront plus exposés. L’entrée des paniers de ponte doit toujours être orienté au sud. L’intérieur sera garni d’une couche de foin d’herbe, plus résistant que la paille. Posés en pleine eau, à une dizaine de mètres des rives, les paniers seront fixés à environ 30 centimètres au-dessus de la surface de l’eau, sur quatre piquets croisés… Au Canada, l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba sont actuellement aux prises avec des populations établies de sangliers. Leur nombre croissant inquiète depuis plusieurs années Ryan Brook de l'Université de la Saskatchewan, qui suit la colonisation des bêtes noires. L'objectif du chercheur est de déterminer le nombre de sangliers sauvages, afin d'enclencher des mesures de dépeuplement, partout où c’est déjà nécessaire. Le chercheur appelle donc tous ses concitoyens témoins de la présence de ces animaux, pour l’aider à les comptabiliser. Déjà en 2015, le professeur avait sonné l’alarme, en affirmant que le nombre de sangliers sauvages pourrait dépasser celui de la population saskatchewanaise. « L’ouverture de la saison de la chasse ne résout pas le problème, en raison du taux de fécondité élevé des sangliers… Si vous en laissez certains et attendez une année, vous allez vous retrouver avec le même nombre. On ne voit aucun résultat tant que l’on ne commence pas à éliminer un groupe entier… » a-t-il déclaré, ajoutant : « Importés d’Europe et d’Asie dans les années 1980, pour peupler des élevages, des animaux se sont échappés accidentellement. Mais des producteurs ont aussi cessé leur activité, et ont coupé leurs clôtures pour les laisser sortir des enclos… Dans de nombreuses régions du Canada, les sangliers n'ont pas de prédateurs naturels significatifs. Ils se reproduisent donc en masse, et comme ils ont une faculté d’adaptation phénoménale, ils survivent dans une variété d’habitats, y compris les forêts, les zones agricoles et même les zones urbaines. Les cultures et les fruits sauvages sont disponibles en grande quantité, ce qui favorise encore sa prolificité… ».
Au Canada, l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba sont actuellement aux prises avec des populations établies de sangliers. Leur nombre croissant inquiète depuis plusieurs années Ryan Brook de l'Université de la Saskatchewan, qui suit la colonisation des bêtes noires. L'objectif du chercheur est de déterminer le nombre de sangliers sauvages, afin d'enclencher des mesures de dépeuplement, partout où c’est déjà nécessaire. Le chercheur appelle donc tous ses concitoyens témoins de la présence de ces animaux, pour l’aider à les comptabiliser. Déjà en 2015, le professeur avait sonné l’alarme, en affirmant que le nombre de sangliers sauvages pourrait dépasser celui de la population saskatchewanaise. « L’ouverture de la saison de la chasse ne résout pas le problème, en raison du taux de fécondité élevé des sangliers… Si vous en laissez certains et attendez une année, vous allez vous retrouver avec le même nombre. On ne voit aucun résultat tant que l’on ne commence pas à éliminer un groupe entier… » a-t-il déclaré, ajoutant : « Importés d’Europe et d’Asie dans les années 1980, pour peupler des élevages, des animaux se sont échappés accidentellement. Mais des producteurs ont aussi cessé leur activité, et ont coupé leurs clôtures pour les laisser sortir des enclos… Dans de nombreuses régions du Canada, les sangliers n'ont pas de prédateurs naturels significatifs. Ils se reproduisent donc en masse, et comme ils ont une faculté d’adaptation phénoménale, ils survivent dans une variété d’habitats, y compris les forêts, les zones agricoles et même les zones urbaines. Les cultures et les fruits sauvages sont disponibles en grande quantité, ce qui favorise encore sa prolificité… ».