Le parcours d’Ellie Lobel, physicienne britannique atteinte depuis quinze ans de la maladie de Lyme, a bouleversé le corps médical. Hospitalisée en Californie et placée en soins palliatifs, elle ne voyait plus d’issue à des douleurs chroniques devenues insupportables. Pourtant, un événement inattendu a changé le cours de sa vie : une attaque d’abeilles africanisées, redoutées pour leur agressivité.  Victime de multiples piqûres, la patiente pensait succomber à un choc anaphylactique. Contre toute attente, ses symptômes ont commencé à s’estomper. Quatre jours plus tard, fièvre, inflammations et fatigue cognitive s’étaient dissipées. Selon ses médecins, la bactérie responsable de la maladie de Lyme, Borrelia burgdorferi, semblait avoir disparu de son organisme. Cette guérison spectaculaire a conduit certains chercheurs à s’intéresser de plus près au venin d’abeille. L’un de ses composants, la mélittine, est un petit peptide connu pour sa capacité à détruire les membranes bactériennes. Des travaux menés en laboratoire sur des cellules et des modèles animaux ont déjà montré ses propriétés antibactériennes, antifongiques et anti-inflammatoires. Son potentiel antiviral et anticancéreux est également étudié. Néanmoins, les spécialistes insistent : il s’agit d’un cas unique, qui ne saurait être considéré comme un traitement reconnu. Si les venins animaux constituent une piste prometteuse pour de futurs médicaments – comme l’ont déjà montré des recherches sur les venins d’araignée ou de lézard – aucune preuve scientifique solide n’existe encore pour valider l’usage du venin d’abeille contre la maladie de Lyme...
Victime de multiples piqûres, la patiente pensait succomber à un choc anaphylactique. Contre toute attente, ses symptômes ont commencé à s’estomper. Quatre jours plus tard, fièvre, inflammations et fatigue cognitive s’étaient dissipées. Selon ses médecins, la bactérie responsable de la maladie de Lyme, Borrelia burgdorferi, semblait avoir disparu de son organisme. Cette guérison spectaculaire a conduit certains chercheurs à s’intéresser de plus près au venin d’abeille. L’un de ses composants, la mélittine, est un petit peptide connu pour sa capacité à détruire les membranes bactériennes. Des travaux menés en laboratoire sur des cellules et des modèles animaux ont déjà montré ses propriétés antibactériennes, antifongiques et anti-inflammatoires. Son potentiel antiviral et anticancéreux est également étudié. Néanmoins, les spécialistes insistent : il s’agit d’un cas unique, qui ne saurait être considéré comme un traitement reconnu. Si les venins animaux constituent une piste prometteuse pour de futurs médicaments – comme l’ont déjà montré des recherches sur les venins d’araignée ou de lézard – aucune preuve scientifique solide n’existe encore pour valider l’usage du venin d’abeille contre la maladie de Lyme...
Quelques brèves de chez nous et... d'ailleurs

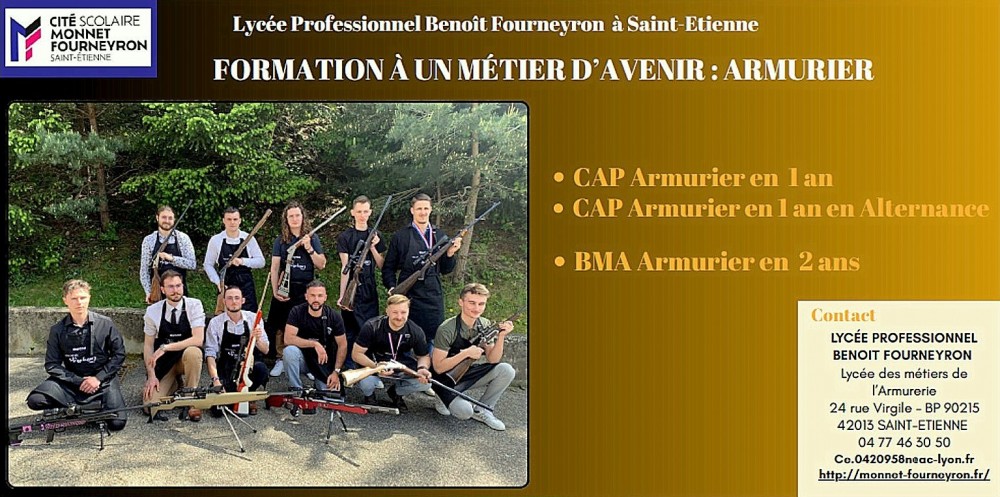
 L’association estime que ces arrêtés, autorisant la chasse dans les Landes, le Lot-et-Garonne, la Gironde, le Gers et les Pyrénées-Atlantiques, vont à l’encontre des textes européens. Selon elle, les filets utilisés seraient « non sélectifs », donc prohibés. Ce discours n’est pas nouveau : depuis des années, les écolos multiplient les recours contre différentes formes de chasse traditionnelle, qu’il s’agisse de l’ortolan, de l’alouette ou désormais de la palombe. C’est un nouvel épisode d’une offensive systématique contre un patrimoine cynégétique multiséculaire. Jusqu’à présent, le Conseil d’État n’avait jamais été amené à trancher sur la palombe. Mais il avait déjà, sous la pression d’associations similaires, interdit d’autres modes de capture jugés contraires au droit européen. De quoi inquiéter les chasseurs du Sud-Ouest, attachés à ces pratiques qui allient tradition, transmission et identité culturelle. Face à cette attaque, la FNC appelle le gouvernement à tenir ses engagements. Dans un communiqué, elle exige que « les services du ministère assurent une défense sans faille de ces chasses patrimoniales devant le Conseil d’État ». Pour les chasseurs, il s’agit avant tout de préserver une culture locale, un savoir-faire transmis de génération en génération, loin des caricatures véhiculées par certaines associations militantes. La décision du Conseil d’État ne pourra sans doute pas être connue avant des mois, mais One Voice espère déjà que 2026 marquera la fin de cette tradition, confirmant ainsi sa volonté d’effacer, petit à petit, toutes les formes de chasse traditionnelle. Même en cas d’annulation, le gouvernement garde la possibilité de publier de nouveaux arrêtés, comme il vient de le faire pour la chasse à l’alouette. Mais là encore, les écolos ont immédiatement annoncé de nouveaux recours. Régis Hargues, directeur de la Fédération départementale des chasseurs des Landes, a réagi : « Nous ne sommes pas surpris de l'attaque, mais nous sommes surpris de ne pas avoir été prévenus » a-t-il déclaré au lendemain de la révélation de la saisine du Conseil d'Etat par One Voice.
L’association estime que ces arrêtés, autorisant la chasse dans les Landes, le Lot-et-Garonne, la Gironde, le Gers et les Pyrénées-Atlantiques, vont à l’encontre des textes européens. Selon elle, les filets utilisés seraient « non sélectifs », donc prohibés. Ce discours n’est pas nouveau : depuis des années, les écolos multiplient les recours contre différentes formes de chasse traditionnelle, qu’il s’agisse de l’ortolan, de l’alouette ou désormais de la palombe. C’est un nouvel épisode d’une offensive systématique contre un patrimoine cynégétique multiséculaire. Jusqu’à présent, le Conseil d’État n’avait jamais été amené à trancher sur la palombe. Mais il avait déjà, sous la pression d’associations similaires, interdit d’autres modes de capture jugés contraires au droit européen. De quoi inquiéter les chasseurs du Sud-Ouest, attachés à ces pratiques qui allient tradition, transmission et identité culturelle. Face à cette attaque, la FNC appelle le gouvernement à tenir ses engagements. Dans un communiqué, elle exige que « les services du ministère assurent une défense sans faille de ces chasses patrimoniales devant le Conseil d’État ». Pour les chasseurs, il s’agit avant tout de préserver une culture locale, un savoir-faire transmis de génération en génération, loin des caricatures véhiculées par certaines associations militantes. La décision du Conseil d’État ne pourra sans doute pas être connue avant des mois, mais One Voice espère déjà que 2026 marquera la fin de cette tradition, confirmant ainsi sa volonté d’effacer, petit à petit, toutes les formes de chasse traditionnelle. Même en cas d’annulation, le gouvernement garde la possibilité de publier de nouveaux arrêtés, comme il vient de le faire pour la chasse à l’alouette. Mais là encore, les écolos ont immédiatement annoncé de nouveaux recours. Régis Hargues, directeur de la Fédération départementale des chasseurs des Landes, a réagi : « Nous ne sommes pas surpris de l'attaque, mais nous sommes surpris de ne pas avoir été prévenus » a-t-il déclaré au lendemain de la révélation de la saisine du Conseil d'Etat par One Voice. L’opération devrait s’étendre jusqu’en octobre et constitue une étape décisive dans la gestion du site Natura 2000 du golfe d’Ajaccio. L’enjeu est de taille : le rat noir, espèce invasive introduite accidentellement par l’homme (probablement via les bateaux dès l’Antiquité), représente une menace considérable pour les colonies d’oiseaux marins. Prédateur opportuniste, il consomme les œufs, attaque les poussins et perturbe les sites de nidification. À cela s’ajoute la dégradation des habitats, qui fragilise davantage les espèces déjà vulnérables.
L’opération devrait s’étendre jusqu’en octobre et constitue une étape décisive dans la gestion du site Natura 2000 du golfe d’Ajaccio. L’enjeu est de taille : le rat noir, espèce invasive introduite accidentellement par l’homme (probablement via les bateaux dès l’Antiquité), représente une menace considérable pour les colonies d’oiseaux marins. Prédateur opportuniste, il consomme les œufs, attaque les poussins et perturbe les sites de nidification. À cela s’ajoute la dégradation des habitats, qui fragilise davantage les espèces déjà vulnérables.  Parmi elles, on compte les puffins de Scopoli, les puffins Yelkouan, les océanites tempête et les martinets pâles, dont la reproduction est particulièrement lente, chaque couple ne pondant qu’un seul œuf par an. En Corse, on estime que 34 îlots sont infestés par le rat noir, dont onze abritent des colonies d’oiseaux marins en danger. Sur Mezu Mare, environ 800 pièges doivent être installés. L’objectif est de permettre à terme la recolonisation de l’île par le puffin Yelkouan, aujourd’hui absent en raison de la pression exercée par les rats. L’opération s’inscrit dans une démarche de long terme. Comme l’a rappelé Christian Balzano, directeur du SMGS, la dératisation des Sanguinaires est une action prioritaire du document d’objectifs (Docob) élaboré dès 2020. Après plusieurs années de concertation locale et une étude de faisabilité approfondie, le projet entre enfin dans sa phase opérationnelle. Cette initiative bénéficie aussi du soutien du programme européen Life Espèces marines mobiles, coordonné par l’OFB et financé par l’Union européenne et l’État français. Ce programme ambitieux, qui implique douze partenaires, vise à enrayer le déclin de 23 espèces marines d’ici 2030.
Parmi elles, on compte les puffins de Scopoli, les puffins Yelkouan, les océanites tempête et les martinets pâles, dont la reproduction est particulièrement lente, chaque couple ne pondant qu’un seul œuf par an. En Corse, on estime que 34 îlots sont infestés par le rat noir, dont onze abritent des colonies d’oiseaux marins en danger. Sur Mezu Mare, environ 800 pièges doivent être installés. L’objectif est de permettre à terme la recolonisation de l’île par le puffin Yelkouan, aujourd’hui absent en raison de la pression exercée par les rats. L’opération s’inscrit dans une démarche de long terme. Comme l’a rappelé Christian Balzano, directeur du SMGS, la dératisation des Sanguinaires est une action prioritaire du document d’objectifs (Docob) élaboré dès 2020. Après plusieurs années de concertation locale et une étude de faisabilité approfondie, le projet entre enfin dans sa phase opérationnelle. Cette initiative bénéficie aussi du soutien du programme européen Life Espèces marines mobiles, coordonné par l’OFB et financé par l’Union européenne et l’État français. Ce programme ambitieux, qui implique douze partenaires, vise à enrayer le déclin de 23 espèces marines d’ici 2030. Le Dr Steffen Koch, chef de la délégation, et son adjoint Hannes Siege ont accueilli les membres dans ce cadre historique, avant d’ouvrir des échanges centrés sur des projets de recherche et des enjeux de gestion faunistique. Les membres ont présenté plusieurs initiatives soutenues par la délégation. Parmi elles, l’utilisation de l’intelligence artificielle pour l’identification des grands cervidés, destinée à améliorer le suivi et la reconnaissance des individus, ainsi qu’une étude novatrice sur la migration des bécassines, grâce à des balises GPS. Ces projets témoignent de l’engagement du CIC dans les sciences appliquées. La vitalité de la délégation a également été mise en avant avec l’intégration de 25 nouveaux membres, dépassant largement l’objectif de croissance fixé. La section CIC Young Opinion a pour sa part souligné l’enthousiasme et la créativité des jeunes générations investies dans la protection de la faune. Mais l’attention s’est surtout portée sur un sujet sensible : l’expansion rapide du chacal doré (Canis aureus) en Allemagne. Ce carnivore, originaire d’Europe du sud-est, déjà présent dans certaines zones méditerranéennes, colonise désormais de nouvelles régions sans véritable régulation. S’il n’est pas considéré comme une espèce invasive par l’Union européenne, son installation dans les écosystèmes allemands soulève des interrogations majeures...
Le Dr Steffen Koch, chef de la délégation, et son adjoint Hannes Siege ont accueilli les membres dans ce cadre historique, avant d’ouvrir des échanges centrés sur des projets de recherche et des enjeux de gestion faunistique. Les membres ont présenté plusieurs initiatives soutenues par la délégation. Parmi elles, l’utilisation de l’intelligence artificielle pour l’identification des grands cervidés, destinée à améliorer le suivi et la reconnaissance des individus, ainsi qu’une étude novatrice sur la migration des bécassines, grâce à des balises GPS. Ces projets témoignent de l’engagement du CIC dans les sciences appliquées. La vitalité de la délégation a également été mise en avant avec l’intégration de 25 nouveaux membres, dépassant largement l’objectif de croissance fixé. La section CIC Young Opinion a pour sa part souligné l’enthousiasme et la créativité des jeunes générations investies dans la protection de la faune. Mais l’attention s’est surtout portée sur un sujet sensible : l’expansion rapide du chacal doré (Canis aureus) en Allemagne. Ce carnivore, originaire d’Europe du sud-est, déjà présent dans certaines zones méditerranéennes, colonise désormais de nouvelles régions sans véritable régulation. S’il n’est pas considéré comme une espèce invasive par l’Union européenne, son installation dans les écosystèmes allemands soulève des interrogations majeures... L’arrêt vise à réparer un « préjudice écologique » directement lié à l’usage des produits phytopharmaceutiques, avec des conséquences reconnues sur la santé humaine et l’environnement. Le jugement reproche aux autorités françaises, et en particulier à l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES), de ne pas avoir respecté les obligations fixées par le règlement européen de 2009. Celui-ci interdit la commercialisation de pesticides susceptibles d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine, animale ou sur les écosystèmes.
L’arrêt vise à réparer un « préjudice écologique » directement lié à l’usage des produits phytopharmaceutiques, avec des conséquences reconnues sur la santé humaine et l’environnement. Le jugement reproche aux autorités françaises, et en particulier à l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES), de ne pas avoir respecté les obligations fixées par le règlement européen de 2009. Celui-ci interdit la commercialisation de pesticides susceptibles d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine, animale ou sur les écosystèmes.  Or, selon la cour, l’ANSES n’a pas évalué les produits en fonction des dernières avancées scientifiques, notamment concernant leurs impacts sur les espèces non ciblées comme les insectes pollinisateurs. La Cour enjoint donc à l’État de mettre en œuvre, dans un délai de vingt-quatre mois, une évaluation complète des risques liés aux pesticides. Elle précise que toutes les autorisations délivrées sur la base de méthodologies jugées insuffisantes devront être réexaminées et, le cas échéant, corrigées ou retirées. Cette décision marque un durcissement par rapport au jugement de première instance rendu en juin 2023. À l’époque, le tribunal administratif s’était contenté d’enjoindre au gouvernement de prendre des mesures pour réparer le préjudice écologique, sans obligation précise de revoir les autorisations existantes. Insatisfaites, les associations environnementales avaient fait appel afin de combler les lacunes des méthodes d’évaluation. Elles obtiennent aujourd’hui gain de cause, parlant d’une « victoire historique ». Ce jugement ouvre la voie à un renforcement du contrôle des pesticides en France et pourrait avoir des répercussions importantes sur l’industrie phytosanitaire. Il consacre surtout le principe selon lequel les politiques publiques doivent s’adapter aux connaissances scientifiques les plus récentes pour garantir la protection de la biodiversité et de la santé des populations.
Or, selon la cour, l’ANSES n’a pas évalué les produits en fonction des dernières avancées scientifiques, notamment concernant leurs impacts sur les espèces non ciblées comme les insectes pollinisateurs. La Cour enjoint donc à l’État de mettre en œuvre, dans un délai de vingt-quatre mois, une évaluation complète des risques liés aux pesticides. Elle précise que toutes les autorisations délivrées sur la base de méthodologies jugées insuffisantes devront être réexaminées et, le cas échéant, corrigées ou retirées. Cette décision marque un durcissement par rapport au jugement de première instance rendu en juin 2023. À l’époque, le tribunal administratif s’était contenté d’enjoindre au gouvernement de prendre des mesures pour réparer le préjudice écologique, sans obligation précise de revoir les autorisations existantes. Insatisfaites, les associations environnementales avaient fait appel afin de combler les lacunes des méthodes d’évaluation. Elles obtiennent aujourd’hui gain de cause, parlant d’une « victoire historique ». Ce jugement ouvre la voie à un renforcement du contrôle des pesticides en France et pourrait avoir des répercussions importantes sur l’industrie phytosanitaire. Il consacre surtout le principe selon lequel les politiques publiques doivent s’adapter aux connaissances scientifiques les plus récentes pour garantir la protection de la biodiversité et de la santé des populations. Jacques Aurange, président de la FDC se dit préoccupé : « Les indices de présence montrent que les sangliers demeurent nombreux et que leur reproduction reste soutenue. Cette situation risque d’entraîner de nouvelles dégradations dans les cultures et les forêts, accentuant la pression sur le monde agricole. Nous avons déjà connu des saisons difficiles, mais celle qui s’annonce pourrait être du même ordre », confie-t-il, appelant à la vigilance et à une implication forte de tous les chasseurs.
Jacques Aurange, président de la FDC se dit préoccupé : « Les indices de présence montrent que les sangliers demeurent nombreux et que leur reproduction reste soutenue. Cette situation risque d’entraîner de nouvelles dégradations dans les cultures et les forêts, accentuant la pression sur le monde agricole. Nous avons déjà connu des saisons difficiles, mais celle qui s’annonce pourrait être du même ordre », confie-t-il, appelant à la vigilance et à une implication forte de tous les chasseurs.  Les secouristes sont parvenus à l’extraire rapidement et sans dommage, malgré un environnement très dangereux. L’intervention ne sera pas facturée au randonneur, mais son prix réel pour l’État se chiffre en plusieurs milliers d’euros, puisque, selon la Cour des comptes, une heure de vol d’hélicoptère est de l’ordre de 5 000 €. Sur Facebook, le PGHM a rappelé un message simple : « Soyez prudents ». Ce sauvetage illustre une nouvelle fois l’importance de mesurer ses capacités face à la haute montagne.
Les secouristes sont parvenus à l’extraire rapidement et sans dommage, malgré un environnement très dangereux. L’intervention ne sera pas facturée au randonneur, mais son prix réel pour l’État se chiffre en plusieurs milliers d’euros, puisque, selon la Cour des comptes, une heure de vol d’hélicoptère est de l’ordre de 5 000 €. Sur Facebook, le PGHM a rappelé un message simple : « Soyez prudents ». Ce sauvetage illustre une nouvelle fois l’importance de mesurer ses capacités face à la haute montagne. Quant au second, il n’a pas montré le même empressement. Resté sur la plateforme de décollage, il s’est contenté de se lisser les plumes et d’observer les alentours. Compte tenu du passage fréquent sur le site, l’oiseau a finalement été replacé en cage pour un relâcher ultérieur. Mais ces initiatives ne font pas l’unanimité. La FDSEA dénonce ces relâchés, estimant que la population de vautours est déjà surabondante et génératrice de dégâts pour les éleveurs. Le syndicat agricole interpelle : « À quand une responsabilité collective et le respect du travail de chacun ? ». Ces débats accompagnent une réalité : plus de 1 000 vautours fauves survolent aujourd’hui les Grands Causses...
Quant au second, il n’a pas montré le même empressement. Resté sur la plateforme de décollage, il s’est contenté de se lisser les plumes et d’observer les alentours. Compte tenu du passage fréquent sur le site, l’oiseau a finalement été replacé en cage pour un relâcher ultérieur. Mais ces initiatives ne font pas l’unanimité. La FDSEA dénonce ces relâchés, estimant que la population de vautours est déjà surabondante et génératrice de dégâts pour les éleveurs. Le syndicat agricole interpelle : « À quand une responsabilité collective et le respect du travail de chacun ? ». Ces débats accompagnent une réalité : plus de 1 000 vautours fauves survolent aujourd’hui les Grands Causses... Son objectif est clair : frapper l’opinion avec des images chocs et caricaturales, au détriment de l’exactitude. Passons donc en revue les principaux arguments. Dès l’introduction, l’ASPAS parle de « terreur », de « sinistre institution », de « tueurs bénévoles », de « tuerie administrative ». Ces termes sont soigneusement choisis pour provoquer l’indignation et le dégoût.
Son objectif est clair : frapper l’opinion avec des images chocs et caricaturales, au détriment de l’exactitude. Passons donc en revue les principaux arguments. Dès l’introduction, l’ASPAS parle de « terreur », de « sinistre institution », de « tueurs bénévoles », de « tuerie administrative ». Ces termes sont soigneusement choisis pour provoquer l’indignation et le dégoût.  Or, un document censé informer devrait présenter des données vérifiables, pas un champ lexical de l’horreur. Cette rhétorique émotionnelle remplace le raisonnement rationnel : c’est une stratégie militante classique, mais pas une analyse sérieuse. Le texte dépeint le chasseur comme un sadique sanguinaire, jouissant de la souffrance des animaux et posant avec des trophées « ensanglantés ». Or, cette image ne reflète ni la diversité du monde de la chasse, ni la réalité réglementaire française :
Or, un document censé informer devrait présenter des données vérifiables, pas un champ lexical de l’horreur. Cette rhétorique émotionnelle remplace le raisonnement rationnel : c’est une stratégie militante classique, mais pas une analyse sérieuse. Le texte dépeint le chasseur comme un sadique sanguinaire, jouissant de la souffrance des animaux et posant avec des trophées « ensanglantés ». Or, cette image ne reflète ni la diversité du monde de la chasse, ni la réalité réglementaire française : Cependant, la réussite de cette prévention repose sur une compréhension fine de la répartition des espèces introduites, et de la dynamique des invasions au fil du temps. Malheureusement, les données existantes restent fragmentaires, inégales selon les régions et souvent incomplètes. Si des inventaires régionaux ou spécifiques à certains groupes taxonomiques existent, une vision globale est rare. L’évaluation menée par l’IPBES (Groupe intergouvernemental sur la biodiversité et les services écosystémiques) constitue donc un apport majeur, en dressant un état des lieux mondial des espèces exotiques dans différents taxons (bactéries, protozoaires, champignons, plantes et animaux).
Cependant, la réussite de cette prévention repose sur une compréhension fine de la répartition des espèces introduites, et de la dynamique des invasions au fil du temps. Malheureusement, les données existantes restent fragmentaires, inégales selon les régions et souvent incomplètes. Si des inventaires régionaux ou spécifiques à certains groupes taxonomiques existent, une vision globale est rare. L’évaluation menée par l’IPBES (Groupe intergouvernemental sur la biodiversité et les services écosystémiques) constitue donc un apport majeur, en dressant un état des lieux mondial des espèces exotiques dans différents taxons (bactéries, protozoaires, champignons, plantes et animaux).  Les résultats confirment la présence d’espèces exotiques dans toutes les régions, y compris dans des zones isolées comme l’Antarctique ou les îles éloignées. Leur nombre est en constante augmentation et cette tendance s’accélère, quel que soit le groupe biologique étudié. L’évaluation met en lumière la difficulté d’obtenir un suivi fiable. Cependant, l’étude identifie six défis majeurs : améliorer la couverture géographique et taxonomique des données, harmoniser les méthodes de suivi, renforcer la coopération internationale, intégrer de nouvelles technologies, mieux relier la recherche scientifique à la décision politique et développer des stratégies de prévention efficaces. Elle souligne aussi l’urgence de combler les lacunes de connaissances afin de guider les politiques publiques et de renforcer les capacités de réponse face à ce phénomène global.
Les résultats confirment la présence d’espèces exotiques dans toutes les régions, y compris dans des zones isolées comme l’Antarctique ou les îles éloignées. Leur nombre est en constante augmentation et cette tendance s’accélère, quel que soit le groupe biologique étudié. L’évaluation met en lumière la difficulté d’obtenir un suivi fiable. Cependant, l’étude identifie six défis majeurs : améliorer la couverture géographique et taxonomique des données, harmoniser les méthodes de suivi, renforcer la coopération internationale, intégrer de nouvelles technologies, mieux relier la recherche scientifique à la décision politique et développer des stratégies de prévention efficaces. Elle souligne aussi l’urgence de combler les lacunes de connaissances afin de guider les politiques publiques et de renforcer les capacités de réponse face à ce phénomène global. Un des axes majeurs de la rencontre a été la communication, tant avec les chasseurs qu’avec le grand public. Les participants ont souligné la nécessité d’une approche proactive, de campagnes conjointes et du partage de bonnes pratiques afin de mettre en lumière le rôle essentiel des chasseurs dans la gestion durable de la faune, la préservation des habitats et leur contribution sociale et culturelle. La hausse significative du nombre de femmes pratiquant la chasse a également été discutée. Cette tendance, perçue comme une évolution positive, offre l’opportunité d’élargir l’image de la chasse et de toucher de nouveaux publics. Plusieurs dossiers politiques figuraient à l’ordre du jour. Les échanges ont porté sur la conservation des oiseaux et l’application de la directive européenne « Oiseaux », la gestion des grands carnivores dans une optique de coexistence équilibrée, le règlement REACH concernant les munitions, ainsi que le bien-être animal. Sur ce dernier point, l’objectif reste d’assurer des standards élevés sans compromettre les pratiques cynégétiques durables. Au-delà des discussions stratégiques, la rencontre a également comporté des démonstrations de terrain. Les délégués ont découvert les initiatives locales pour la gestion de la perdrix grise et des populations d’oies, dont certaines techniques visent à limiter les dégâts agricoles.
Un des axes majeurs de la rencontre a été la communication, tant avec les chasseurs qu’avec le grand public. Les participants ont souligné la nécessité d’une approche proactive, de campagnes conjointes et du partage de bonnes pratiques afin de mettre en lumière le rôle essentiel des chasseurs dans la gestion durable de la faune, la préservation des habitats et leur contribution sociale et culturelle. La hausse significative du nombre de femmes pratiquant la chasse a également été discutée. Cette tendance, perçue comme une évolution positive, offre l’opportunité d’élargir l’image de la chasse et de toucher de nouveaux publics. Plusieurs dossiers politiques figuraient à l’ordre du jour. Les échanges ont porté sur la conservation des oiseaux et l’application de la directive européenne « Oiseaux », la gestion des grands carnivores dans une optique de coexistence équilibrée, le règlement REACH concernant les munitions, ainsi que le bien-être animal. Sur ce dernier point, l’objectif reste d’assurer des standards élevés sans compromettre les pratiques cynégétiques durables. Au-delà des discussions stratégiques, la rencontre a également comporté des démonstrations de terrain. Les délégués ont découvert les initiatives locales pour la gestion de la perdrix grise et des populations d’oies, dont certaines techniques visent à limiter les dégâts agricoles. Au programme : la cérémonie d’ouverture officielle, des événements exclusifs dans des lieux emblématiques tels que le Musée d’Histoire Naturelle de Vienne et le somptueux Palais Liechtenstein, ainsi que le prestigieux dîner de gala accompagné d’une vente aux enchères de chasse. Ces occasions offriront un cadre idéal pour échanger, nouer des partenariats et célébrer les efforts de conservation à l’échelle mondiale. Les participants pourront également assister à des sessions portant sur l’économie de la faune sauvage, son utilisation durable et les principaux défis politiques qui façonnent son avenir et celui de la chasse. L’annonce des intervenants et le programme détaillé seront communiqués prochainement, promettant un agenda riche en idées novatrices et en discussions stratégiques. Le CIC souhaite également inviter chaleureusement les donateurs qui ont fait des promesses de dons aux enchères, afin de soutenir directement ses efforts de conservation à travers le monde. Ne manquez donc pas cette occasion exceptionnelle de rejoindre la communauté mondiale des acteurs de la conservation et de partager vos expériences. Vienne et le CIC vous attendent pour un rassemblement influent, enrichissant et inoubliable, où diplomatie, conservation et passion pour la nature se rencontreront au cœur de l’Europe.
Au programme : la cérémonie d’ouverture officielle, des événements exclusifs dans des lieux emblématiques tels que le Musée d’Histoire Naturelle de Vienne et le somptueux Palais Liechtenstein, ainsi que le prestigieux dîner de gala accompagné d’une vente aux enchères de chasse. Ces occasions offriront un cadre idéal pour échanger, nouer des partenariats et célébrer les efforts de conservation à l’échelle mondiale. Les participants pourront également assister à des sessions portant sur l’économie de la faune sauvage, son utilisation durable et les principaux défis politiques qui façonnent son avenir et celui de la chasse. L’annonce des intervenants et le programme détaillé seront communiqués prochainement, promettant un agenda riche en idées novatrices et en discussions stratégiques. Le CIC souhaite également inviter chaleureusement les donateurs qui ont fait des promesses de dons aux enchères, afin de soutenir directement ses efforts de conservation à travers le monde. Ne manquez donc pas cette occasion exceptionnelle de rejoindre la communauté mondiale des acteurs de la conservation et de partager vos expériences. Vienne et le CIC vous attendent pour un rassemblement influent, enrichissant et inoubliable, où diplomatie, conservation et passion pour la nature se rencontreront au cœur de l’Europe. À travers des échanges d’experts, de décideurs et de parties prenantes, les discussions viseront à montrer comment conservation et utilisation durable peuvent aller de pair, dans une logique gagnant-gagnant pour la nature et les sociétés humaines. Parmi les thématiques abordées :
À travers des échanges d’experts, de décideurs et de parties prenantes, les discussions viseront à montrer comment conservation et utilisation durable peuvent aller de pair, dans une logique gagnant-gagnant pour la nature et les sociétés humaines. Parmi les thématiques abordées : Le cerf, « roi de la forêt », occupe une place à part dans l’imaginaire collectif. Plus grand mammifère des forêts françaises, cet animal emblématique a façonné l’histoire des forêts royales, Rambouillet, Fontainebleau et Chantilly, qui furent protégées pour garantir la présence de gibier à proximité de la cour. L’Espace Rambouillet, réserve de 250 hectares, intégrée dans les 26 000 hectares de la forêt domaniale, accueille une faune variée, a été créé en 1972 par l’Office national des forêts. Le point névralgique de cette saison est donc la « place de brame », une clairière où les grands cervidés se rassemblent.
Le cerf, « roi de la forêt », occupe une place à part dans l’imaginaire collectif. Plus grand mammifère des forêts françaises, cet animal emblématique a façonné l’histoire des forêts royales, Rambouillet, Fontainebleau et Chantilly, qui furent protégées pour garantir la présence de gibier à proximité de la cour. L’Espace Rambouillet, réserve de 250 hectares, intégrée dans les 26 000 hectares de la forêt domaniale, accueille une faune variée, a été créé en 1972 par l’Office national des forêts. Le point névralgique de cette saison est donc la « place de brame », une clairière où les grands cervidés se rassemblent.  Les mâles y rivalisent de puissance pour conquérir leurs partenaires. Durant ces semaines intenses, le cerf, habituellement discret, devient bruyant et spectaculaire : il pousse des cris puissants (les raires), marque son territoire, et affronte ses rivaux. Si le spectacle est fascinant, il demande aussi respect et précaution. Les cerfs restent des animaux sauvages et très sensibles aux dérangements humains. Les spécialistes rappellent qu’il est préférable de les observer accompagné d’un guide ou d’un agent forestier, afin de ne pas perturber cette période cruciale de reproduction. La retransmission en direct, accessible sur france.tv, constitue donc une occasion rare d’observer, sans déranger, ce phénomène. Elle permet également de sensibiliser le grand public à la préservation des forêts et de leurs habitants. Plus qu’un simple spectacle naturel, le brame du cerf est un héritage vivant, désormais accessible à tous grâce au numérique. A suivre 24h/24 sur france.tv/idf, à partir du 8 septembre 2025 à 18 heures.
Les mâles y rivalisent de puissance pour conquérir leurs partenaires. Durant ces semaines intenses, le cerf, habituellement discret, devient bruyant et spectaculaire : il pousse des cris puissants (les raires), marque son territoire, et affronte ses rivaux. Si le spectacle est fascinant, il demande aussi respect et précaution. Les cerfs restent des animaux sauvages et très sensibles aux dérangements humains. Les spécialistes rappellent qu’il est préférable de les observer accompagné d’un guide ou d’un agent forestier, afin de ne pas perturber cette période cruciale de reproduction. La retransmission en direct, accessible sur france.tv, constitue donc une occasion rare d’observer, sans déranger, ce phénomène. Elle permet également de sensibiliser le grand public à la préservation des forêts et de leurs habitants. Plus qu’un simple spectacle naturel, le brame du cerf est un héritage vivant, désormais accessible à tous grâce au numérique. A suivre 24h/24 sur france.tv/idf, à partir du 8 septembre 2025 à 18 heures.