 La recherche du grand gibier blessé concerne tous les modes de chasse à tir et toutes les régions. Elle est réalisable par de multiples races de chiens utilisés à la chasse, ou spécialistes de cette activité.
La recherche du grand gibier blessé concerne tous les modes de chasse à tir et toutes les régions. Elle est réalisable par de multiples races de chiens utilisés à la chasse, ou spécialistes de cette activité.  Elle est le devoir éthique et moral de tout chasseur de grand gibier et, à ce jour, rien n’a encore été trouvé de plus efficace que le travail d’un chien éduqué à cela. L’UNUCR (Union Nationale des Utilisateurs de Chiens de Rouge) a donc programmé, pour cette année 2024, quatre stages de formation, à l’intention des futurs conducteurs, mais aussi de tous les chasseurs de grand gibier que cette discipline intéresse. La formation du conducteur et l’éducation d’un chiot relèvent d’un haut niveau de formation. C’est pourquoi, pour chaque session, l’UNUCR fait appel à des moniteurs et conducteurs parmi les plus expérimentés, et qui traiteront les sujets suivants : - le comportement du chasseur ; - le contrôle de tir et indices de blessures ; - le choix et l’éducation du chiot ; - la pratique de la recherche ; - les différentes races utilisées ; - la balistique ; - les aptitudes requises ; - la législation… en plus de ces enseignements, quelques heures sur le terrain sont consacrées à l’étude des indices de tir et de blessures, et aux démonstrations de poses de pistes et de travail. Les stages 2024 :
Elle est le devoir éthique et moral de tout chasseur de grand gibier et, à ce jour, rien n’a encore été trouvé de plus efficace que le travail d’un chien éduqué à cela. L’UNUCR (Union Nationale des Utilisateurs de Chiens de Rouge) a donc programmé, pour cette année 2024, quatre stages de formation, à l’intention des futurs conducteurs, mais aussi de tous les chasseurs de grand gibier que cette discipline intéresse. La formation du conducteur et l’éducation d’un chiot relèvent d’un haut niveau de formation. C’est pourquoi, pour chaque session, l’UNUCR fait appel à des moniteurs et conducteurs parmi les plus expérimentés, et qui traiteront les sujets suivants : - le comportement du chasseur ; - le contrôle de tir et indices de blessures ; - le choix et l’éducation du chiot ; - la pratique de la recherche ; - les différentes races utilisées ; - la balistique ; - les aptitudes requises ; - la législation… en plus de ces enseignements, quelques heures sur le terrain sont consacrées à l’étude des indices de tir et de blessures, et aux démonstrations de poses de pistes et de travail. Les stages 2024 :
- Stage n° 1 : il se déroulera les 20 et 21 avril 2024, à Réalville (82). Pour s’inscrire : contacter Nicolas Dejean (courriel : nicolas.dejean.unucr@gmail.com), Tél. : 06 60 62 81 91.
Stage n° 1 : il se déroulera les 20 et 21 avril 2024, à Réalville (82). Pour s’inscrire : contacter Nicolas Dejean (courriel : nicolas.dejean.unucr@gmail.com), Tél. : 06 60 62 81 91.
- Stage n° 2 : il aura lieu du 3 au 5 mai 2024, à La Bourboule (63). Pour s’inscrire : contacter Arnaud Bongrand (courriel : arnaudbongrand58@gmail.com), Tél. : 06 01 13 66 32.
- Stage n° 3 : il aura lieu les 4 et 5 mai 2024, à Thilouze (37). Pour s’inscrire : contacter Olivier Donguy (courriel : olivierdonguy@orange.fr), Tél : 06 07 60 76 97.
- Stage n° 4 : il se déroulera du 7 au 9 juin 2024, à Benoîte Vaux (55). Pour s’inscrire : contacter Arnaud Bongrand (courriel : arnaudbongrand58@gmail.com), Tél. : 06 01 13 66 32.
A noter que les frais de stage n°2 et n° 4 sont gratuits pour les moins de 25 ans, et pour ces deux stages les stagiaires seront logés sur place.

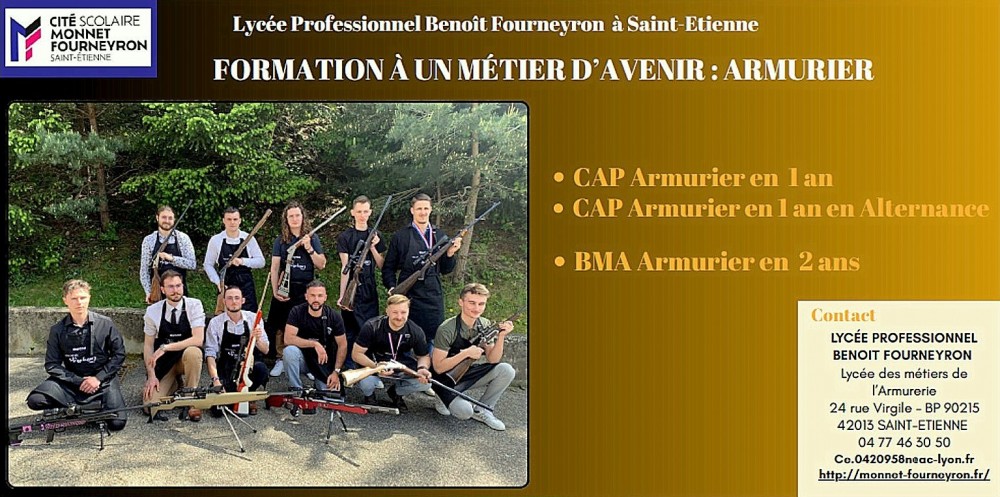
 Ce fut l’une des pires catastrophes qui ont sensibilisé l’opinion publique américaine, conduisant à l’adoption de lois sur la protection de l’environnement. Mais cette rivière Cuyahoga n’était pas la seule touchée… En 2014, le lac Érié, après des décennies de pollution industrielle et agricole, était envahi par des algues toxiques, privant près d'un million de personnes, d’eau potable pendant plusieurs jours. C’est cet événement qui a poussé les habitants à se demander si les lois environnementales protégeaient réellement les écosystèmes. C’est dans ce contexte qu’Andrea Bowers présente son exposition « Existez, Prospérez et Évoluez » au Cleveland Museum of Contemporary Art. L’artiste, originaire de l’Ohio et reconnue à l’échelle internationale, s’est inspirée de la « Lake Erie Bill of Rights » (Déclaration des droits du lac Erié) en 2019, pour nommer son exposition. Cette loi vise à établir une équivalence juridique entre les droits des cours d’eau et les intérêts de l’industrie. Le mouvement pour les droits de la nature n’est pas unique aux États-Unis. Des pays tels que l’Équateur, le Panama, la Bolivie et l’Espagne reconnaissent les droits des rivières, des lacs, des forêts et de la faune, dont les lois nationales respectives offrent une protection plus importante que les réglementations environnementales classiques, et permettent à des individus désignés d’appliquer ces droits en tant que gardiens légaux. « Existez, Prospérez et Évoluez » invite à réfléchir aux arguments philosophiques sous-tendant le mouvement pour les droits de la nature, qui n’est pas simplement une chose ou une propriété humaine, mais une communauté complexe à laquelle les êtres humains appartiennent. La science moderne confirme de plus en plus souvent cette idée, invitant les systèmes juridiques à s’adapter à cette réalité…
Ce fut l’une des pires catastrophes qui ont sensibilisé l’opinion publique américaine, conduisant à l’adoption de lois sur la protection de l’environnement. Mais cette rivière Cuyahoga n’était pas la seule touchée… En 2014, le lac Érié, après des décennies de pollution industrielle et agricole, était envahi par des algues toxiques, privant près d'un million de personnes, d’eau potable pendant plusieurs jours. C’est cet événement qui a poussé les habitants à se demander si les lois environnementales protégeaient réellement les écosystèmes. C’est dans ce contexte qu’Andrea Bowers présente son exposition « Existez, Prospérez et Évoluez » au Cleveland Museum of Contemporary Art. L’artiste, originaire de l’Ohio et reconnue à l’échelle internationale, s’est inspirée de la « Lake Erie Bill of Rights » (Déclaration des droits du lac Erié) en 2019, pour nommer son exposition. Cette loi vise à établir une équivalence juridique entre les droits des cours d’eau et les intérêts de l’industrie. Le mouvement pour les droits de la nature n’est pas unique aux États-Unis. Des pays tels que l’Équateur, le Panama, la Bolivie et l’Espagne reconnaissent les droits des rivières, des lacs, des forêts et de la faune, dont les lois nationales respectives offrent une protection plus importante que les réglementations environnementales classiques, et permettent à des individus désignés d’appliquer ces droits en tant que gardiens légaux. « Existez, Prospérez et Évoluez » invite à réfléchir aux arguments philosophiques sous-tendant le mouvement pour les droits de la nature, qui n’est pas simplement une chose ou une propriété humaine, mais une communauté complexe à laquelle les êtres humains appartiennent. La science moderne confirme de plus en plus souvent cette idée, invitant les systèmes juridiques à s’adapter à cette réalité… Pour la première fois « J’aime la Nature Propre », lancée en 2021 par la FNC se tiendra partout en France pendant le même week-end, du 15 au 17 mars. Cette opération citoyenne de ramassage de déchets est cofinancée par l’OFB, via le dispositif écocontribution. En 2023, près de 10 000 m3 de déchets avaient été ramassés, avec la participation de 41 FDC. Cette année, c’est l’ensemble du corps fédéral qui sera sur le terrain, l’objectif étant de déployer un maximum de lieux de ramassage tout en mobilisant le plus grand nombre de volontaires. Deux solutions sont proposées : il est possible d’être volontaire pour un point de ramassage précis ou d’être soi-même à l’initiative d’un point de collecte. Au-delà de son objectif environnemental et pédagogique, « J’aime la Nature Propre » a également vocation à favoriser les échanges entre les usagers de la nature. Aux côtés des FDC, d’autres fédérations de sports de plein air sont partenaires au niveau national ou local, telles que la Mountain Bikers Foundation (MBF) et la Fédération Française de Course d’Orientation (FFCO), qui ont mobilisé leurs adhérents.
Pour la première fois « J’aime la Nature Propre », lancée en 2021 par la FNC se tiendra partout en France pendant le même week-end, du 15 au 17 mars. Cette opération citoyenne de ramassage de déchets est cofinancée par l’OFB, via le dispositif écocontribution. En 2023, près de 10 000 m3 de déchets avaient été ramassés, avec la participation de 41 FDC. Cette année, c’est l’ensemble du corps fédéral qui sera sur le terrain, l’objectif étant de déployer un maximum de lieux de ramassage tout en mobilisant le plus grand nombre de volontaires. Deux solutions sont proposées : il est possible d’être volontaire pour un point de ramassage précis ou d’être soi-même à l’initiative d’un point de collecte. Au-delà de son objectif environnemental et pédagogique, « J’aime la Nature Propre » a également vocation à favoriser les échanges entre les usagers de la nature. Aux côtés des FDC, d’autres fédérations de sports de plein air sont partenaires au niveau national ou local, telles que la Mountain Bikers Foundation (MBF) et la Fédération Française de Course d’Orientation (FFCO), qui ont mobilisé leurs adhérents. D’après une étude danoise publiée dans « Biology Letters », la chasse favorise l’intelligence des oiseaux. Les scientifiques ont comparé la taille et le poids des cerveaux de 3781 oiseaux appartenant à 197 espèces. L’ornithologiste Johannes Erritzøe a procédé à l’autopsie de ces oiseaux afin de comparer la taille de différents organes : cœur, poumons, foie… mais seule la taille du cerveau différait chez les espèces chassées. « Cela signifie que la chasse a un effet particulier et spécifique sur le cerveau et non sur les fonctions corporelles de ces animaux » résume Anders Pape Møller, un des auteurs de l’étude. Certains scientifiques sont toutefois sceptiques sur ces résultats, comme Jesper Madsen, de l’Université Aarhaus au Danemark, qui pense que l’on ne peut pas simplement se baser sur une corrélation tirée d’une comparaison de données. Cette objection a fait réagir Anders Pape Møller qui précise qu’une expérience est en cours sans qu’il ne la provoque, et permise par l’interdiction de la chasse de certaines espèces depuis plusieurs années en Europe. Les chercheurs pourraient donc comparer la taille des cerveaux d’oiseaux chassés avant la période d’interdiction et après, pour voir si une sélection a réellement été exercée par la chasse.
D’après une étude danoise publiée dans « Biology Letters », la chasse favorise l’intelligence des oiseaux. Les scientifiques ont comparé la taille et le poids des cerveaux de 3781 oiseaux appartenant à 197 espèces. L’ornithologiste Johannes Erritzøe a procédé à l’autopsie de ces oiseaux afin de comparer la taille de différents organes : cœur, poumons, foie… mais seule la taille du cerveau différait chez les espèces chassées. « Cela signifie que la chasse a un effet particulier et spécifique sur le cerveau et non sur les fonctions corporelles de ces animaux » résume Anders Pape Møller, un des auteurs de l’étude. Certains scientifiques sont toutefois sceptiques sur ces résultats, comme Jesper Madsen, de l’Université Aarhaus au Danemark, qui pense que l’on ne peut pas simplement se baser sur une corrélation tirée d’une comparaison de données. Cette objection a fait réagir Anders Pape Møller qui précise qu’une expérience est en cours sans qu’il ne la provoque, et permise par l’interdiction de la chasse de certaines espèces depuis plusieurs années en Europe. Les chercheurs pourraient donc comparer la taille des cerveaux d’oiseaux chassés avant la période d’interdiction et après, pour voir si une sélection a réellement été exercée par la chasse. Le mot trophée vient du grec « tropaion », et ce terme fait référence à une coutume indo-européenne, vieille d’environ six mille ans. Elle consistait à suspendre, en place publique, des objets pris à l’ennemi sur le champ de bataille, afin de commémorer la victoire. Ces Indo-européens, colonisateurs guerriers, venaient des steppes du nord de la Mer Noire. Cet usage du trophée de guerre, s’est ensuite étendu à la chasse. Les guerriers grecs, chasseurs entre deux conflits, se paraient de défenses de sangliers, de canines et de griffes d’ours. Les Gaulois fixaient, pour décorer leurs casques, des ailes et des cornes, et en Europe centrale, le char de Strettweg, (600 ans av JC, musée de Graz en Autriche) est orné d’un cerf, qui pourrait être une représentation de Cernunnos, dieu de la mythologie gauloise. Après la longue période des croisades en terre sainte (1095-1291),
Le mot trophée vient du grec « tropaion », et ce terme fait référence à une coutume indo-européenne, vieille d’environ six mille ans. Elle consistait à suspendre, en place publique, des objets pris à l’ennemi sur le champ de bataille, afin de commémorer la victoire. Ces Indo-européens, colonisateurs guerriers, venaient des steppes du nord de la Mer Noire. Cet usage du trophée de guerre, s’est ensuite étendu à la chasse. Les guerriers grecs, chasseurs entre deux conflits, se paraient de défenses de sangliers, de canines et de griffes d’ours. Les Gaulois fixaient, pour décorer leurs casques, des ailes et des cornes, et en Europe centrale, le char de Strettweg, (600 ans av JC, musée de Graz en Autriche) est orné d’un cerf, qui pourrait être une représentation de Cernunnos, dieu de la mythologie gauloise. Après la longue période des croisades en terre sainte (1095-1291),  nos insatiables ancêtres engagèrent la guerre de Cent ans contre l’Angleterre (1337-1453). Conflit larvé, entrecoupé de trêves plus ou moins longues, sans de véritable grande bataille, mais qui sera marquée par une occupation anglaise qui explique en partie le développement parallèle de la vénerie dans nos deux pays. Génie politique, passionné de chasse, Gaston Phoebus écrivait entre 1387 et 1389 son livre de chasse, un traité de vénerie qui sera considéré comme un ouvrage de référence jusqu’au 19ème siècle. Bien que les anti-chasse dénoncent, entre autres, cette tradition du trophée, une récente enquête commandée par la FACE et à destination du Parlement européen, met en lumière l'importance mondiale de la chasse pour la conservation, en abordant en particulier cette question des trophées. Le désir, légitime, des chasseurs de conserver un souvenir de leur chasse est largement soutenu, comme l’indiquent les résultats de cette enquête, à la condition cependant que l’animal ait été chassé légalement et dans le respect des réglementations internationales. Cette reconnaissance souligne aussi le rôle de la chasse dans la conservation des ressources à régénération naturelle et la protection des espèces, soulignant la compréhension nuancée et l’acceptation des pratiques de chasse par le public.
nos insatiables ancêtres engagèrent la guerre de Cent ans contre l’Angleterre (1337-1453). Conflit larvé, entrecoupé de trêves plus ou moins longues, sans de véritable grande bataille, mais qui sera marquée par une occupation anglaise qui explique en partie le développement parallèle de la vénerie dans nos deux pays. Génie politique, passionné de chasse, Gaston Phoebus écrivait entre 1387 et 1389 son livre de chasse, un traité de vénerie qui sera considéré comme un ouvrage de référence jusqu’au 19ème siècle. Bien que les anti-chasse dénoncent, entre autres, cette tradition du trophée, une récente enquête commandée par la FACE et à destination du Parlement européen, met en lumière l'importance mondiale de la chasse pour la conservation, en abordant en particulier cette question des trophées. Le désir, légitime, des chasseurs de conserver un souvenir de leur chasse est largement soutenu, comme l’indiquent les résultats de cette enquête, à la condition cependant que l’animal ait été chassé légalement et dans le respect des réglementations internationales. Cette reconnaissance souligne aussi le rôle de la chasse dans la conservation des ressources à régénération naturelle et la protection des espèces, soulignant la compréhension nuancée et l’acceptation des pratiques de chasse par le public. Cette mauvaise nouvelle a été publiée à la suite de la dernière mise à jour de la liste rouge des espèces menacées de l'UICN, en décembre dernier, mais restait suspendue au conditionnel. Selon des scientifiques de l'université Charles Darwin (CDU), en Australie, cette raie pastenague javanaise (Urolophus javanicus) est la première espèce de poisson marin à s'éteindre en raison de l'activité humaine. Cette raie unique, de la taille d'une assiette, n'était connue que par un unique spécimen collecté sur un marché aux poissons de Jakarta, en Indonésie, en 1862. Malgré une surveillance intensive des marchés et des efforts de prospection, aucune trace de cette espèce n'a été trouvée depuis lors. Une réévaluation de son statut « en danger critique d'extinction » a été réalisée depuis 2021, et l'espèce a officiellement été classée éteinte en décembre 2023. L'équipe de scientifiques internationaux a rassemblé toutes les informations disponibles sur l'espèce et a conclu, grâce à la modélisation, que cette espèce a été victime d’une pêche intensive et généralement non réglementée. « Sa disparition constitue un avertissement pour le monde entier. Nous devons protéger les espèces menacées et réfléchir à des stratégies de gestion appropriées, telles que la protection de l'habitat, la réduction de la surpêche, tout en garantissant les moyens de subsistance des personnes qui dépendent de ces ressources halieutiques… » a déclaré le Dr Peter Kyne, chercheur principal à la CDU. La liste rouge recense aujourd'hui plus de 44 000 espèces en voie de disparition, soit près de 30 % des espèces évaluées.
Cette mauvaise nouvelle a été publiée à la suite de la dernière mise à jour de la liste rouge des espèces menacées de l'UICN, en décembre dernier, mais restait suspendue au conditionnel. Selon des scientifiques de l'université Charles Darwin (CDU), en Australie, cette raie pastenague javanaise (Urolophus javanicus) est la première espèce de poisson marin à s'éteindre en raison de l'activité humaine. Cette raie unique, de la taille d'une assiette, n'était connue que par un unique spécimen collecté sur un marché aux poissons de Jakarta, en Indonésie, en 1862. Malgré une surveillance intensive des marchés et des efforts de prospection, aucune trace de cette espèce n'a été trouvée depuis lors. Une réévaluation de son statut « en danger critique d'extinction » a été réalisée depuis 2021, et l'espèce a officiellement été classée éteinte en décembre 2023. L'équipe de scientifiques internationaux a rassemblé toutes les informations disponibles sur l'espèce et a conclu, grâce à la modélisation, que cette espèce a été victime d’une pêche intensive et généralement non réglementée. « Sa disparition constitue un avertissement pour le monde entier. Nous devons protéger les espèces menacées et réfléchir à des stratégies de gestion appropriées, telles que la protection de l'habitat, la réduction de la surpêche, tout en garantissant les moyens de subsistance des personnes qui dépendent de ces ressources halieutiques… » a déclaré le Dr Peter Kyne, chercheur principal à la CDU. La liste rouge recense aujourd'hui plus de 44 000 espèces en voie de disparition, soit près de 30 % des espèces évaluées.  Comme les sangliers disposent de nourriture à volonté, les jeunes femelles peuvent désormais accéder à la maternité vers un an d’âge, semant ainsi des marcassins tout au long de l’année. Ceux qui vont voir le jour dans les semaines qui viennent, généralement pluvieuses, auront une bonne chance de survie si les températures restent clémentes. Si un froid sec est supportable par les nouveaux nés, associé à la pluie il sera leur plus mortel ennemi. En l’absence de « toit » végétal, le taux de mortalité sera élevé, et dans ce cas, il vaut mieux que la portée entière disparaisse. Après un tarissement rapide des mamelles non sollicitées, la laie retrouvera un cycle de chaleurs et repartira pour une gestation de 113 à 117 jours.
Comme les sangliers disposent de nourriture à volonté, les jeunes femelles peuvent désormais accéder à la maternité vers un an d’âge, semant ainsi des marcassins tout au long de l’année. Ceux qui vont voir le jour dans les semaines qui viennent, généralement pluvieuses, auront une bonne chance de survie si les températures restent clémentes. Si un froid sec est supportable par les nouveaux nés, associé à la pluie il sera leur plus mortel ennemi. En l’absence de « toit » végétal, le taux de mortalité sera élevé, et dans ce cas, il vaut mieux que la portée entière disparaisse. Après un tarissement rapide des mamelles non sollicitées, la laie retrouvera un cycle de chaleurs et repartira pour une gestation de 113 à 117 jours.  Mais, s’il ne survit qu’un seul marcassin, elle l’allaitera. Un aménagement sommaire et provisoire peut cependant aider à limiter les nombreuses pertes de marcassins. Peu de temps avant la mise bas, les laies s’isolent. Loin des compagnies, elles préparent, dans un endroit bien abrité des vents mais pouvant recevoir les rayons du soleil, un nid d'environ 1 mètre de diamètre : le chaudron. Construit avec des végétaux (branchettes, mousse, herbes sèches), il est généralement très confortable et moelleux pour accueillir les nouveau-nés.
Mais, s’il ne survit qu’un seul marcassin, elle l’allaitera. Un aménagement sommaire et provisoire peut cependant aider à limiter les nombreuses pertes de marcassins. Peu de temps avant la mise bas, les laies s’isolent. Loin des compagnies, elles préparent, dans un endroit bien abrité des vents mais pouvant recevoir les rayons du soleil, un nid d'environ 1 mètre de diamètre : le chaudron. Construit avec des végétaux (branchettes, mousse, herbes sèches), il est généralement très confortable et moelleux pour accueillir les nouveau-nés.  Ils seront de deux à huit, rarement plus, qui se blottiront les uns contre les autres, toujours prêts à happer une allaite nourricière. Les huit premiers jours seront cruciaux pour eux. Alors, si vous estimez que le couvert végétal manque de consistance, recherchez, dans un endroit éloigné au moins d’une cinquantaine de mètres d’une allée forestière, une trochée de 4 à 6 brins. Ne touchez pas au plus beau, c’est un bois d’avenir, mais entaillez les autres à 60 centimètres du sol, sur la moitié de leur diamètre et couchez-les, côte à côte. De cette façon, ces brins non sectionnés entièrement, resteront alimentés en sève, et rejetteront. Couvrez-les de quelques branchages de résineux et mettez dessous une bonne brassé de paille ou de foin, aspergée de goudron de Norvège. Un toit végétal se reformera, qui pourra durer plusieurs années, toujours apprécié par les futures mamans.
Ils seront de deux à huit, rarement plus, qui se blottiront les uns contre les autres, toujours prêts à happer une allaite nourricière. Les huit premiers jours seront cruciaux pour eux. Alors, si vous estimez que le couvert végétal manque de consistance, recherchez, dans un endroit éloigné au moins d’une cinquantaine de mètres d’une allée forestière, une trochée de 4 à 6 brins. Ne touchez pas au plus beau, c’est un bois d’avenir, mais entaillez les autres à 60 centimètres du sol, sur la moitié de leur diamètre et couchez-les, côte à côte. De cette façon, ces brins non sectionnés entièrement, resteront alimentés en sève, et rejetteront. Couvrez-les de quelques branchages de résineux et mettez dessous une bonne brassé de paille ou de foin, aspergée de goudron de Norvège. Un toit végétal se reformera, qui pourra durer plusieurs années, toujours apprécié par les futures mamans. Le groupe de travail « Communication » de la FACE s'est réuni en Autriche, à Salzbourg, pour un événement instructif organisé par l'Association autrichienne de chasse (Jagd Österreich), à l'occasion du salon « Die Hohe Jagd & Fischerei ». Des sujets cruciaux pour l’avenir de la chasse en Europe étaient à l’ordre du jour, dont l’un des plus important, l'acceptation sociale de la chasse en Europe, a été souligné. Les participants ont engagé des discussions proactives, ainsi que sur les meilleures pratiques en matière de campagnes médiatiques visant à l'améliorer. En particulier, l'Association autrichienne des chasseurs et l'Association des chasseurs danois (Danmarks Jægerforbund) ont présenté un aperçu de leur expérience et de leurs récentes campagnes réussies de communication. L'une des opportunités à venir sera la communication au cours de la campagne des prochaines élections au Parlement européen, en juin prochain. La FACE continuera de travailler activement pour garantir que l'élaboration des politiques de Bruxelles s'aligne sur les intérêts de la chasse et de la conservation durables en Europe, et comment ils doivent être reconnus et soutenus par les décideurs européens. Puis la deuxième partie de ce colloque était consacrée aux réseaux sociaux, au cours de laquelle les représentants de la chasse des pays européens ont pu approcher ce paysage des médias sociaux en constante évolution. Au terme de ces échanges, ce a abouti à la création d’un groupe diversifié d’experts qui se consacrent à faire progresser la chasse et la conservation à travers l’Europe.
Le groupe de travail « Communication » de la FACE s'est réuni en Autriche, à Salzbourg, pour un événement instructif organisé par l'Association autrichienne de chasse (Jagd Österreich), à l'occasion du salon « Die Hohe Jagd & Fischerei ». Des sujets cruciaux pour l’avenir de la chasse en Europe étaient à l’ordre du jour, dont l’un des plus important, l'acceptation sociale de la chasse en Europe, a été souligné. Les participants ont engagé des discussions proactives, ainsi que sur les meilleures pratiques en matière de campagnes médiatiques visant à l'améliorer. En particulier, l'Association autrichienne des chasseurs et l'Association des chasseurs danois (Danmarks Jægerforbund) ont présenté un aperçu de leur expérience et de leurs récentes campagnes réussies de communication. L'une des opportunités à venir sera la communication au cours de la campagne des prochaines élections au Parlement européen, en juin prochain. La FACE continuera de travailler activement pour garantir que l'élaboration des politiques de Bruxelles s'aligne sur les intérêts de la chasse et de la conservation durables en Europe, et comment ils doivent être reconnus et soutenus par les décideurs européens. Puis la deuxième partie de ce colloque était consacrée aux réseaux sociaux, au cours de laquelle les représentants de la chasse des pays européens ont pu approcher ce paysage des médias sociaux en constante évolution. Au terme de ces échanges, ce a abouti à la création d’un groupe diversifié d’experts qui se consacrent à faire progresser la chasse et la conservation à travers l’Europe. Les herbivores créent de nombreux dégâts sur certaines cultures, mais aussi sur des espèces végétales menacées. Or, si certaines plantes dégagent des odeurs qui les attirent, d’autres, à l’inverse, les font fuir. C’est sur ce constat que des chercheurs de l’université de Sydney ont publié les résultats de leur étude dans la revue « Nature Ecology & Evolution ». C’est cette faculté de repousser les animaux qui intéresse les scientifiques, car elle pourrait apporter une nouvelle solution à la protection de cultures essentielles pour l’alimentation humaine ou à la protection d’espèces menacées. Ils proposent donc une nouvelle méthode : recréer l’odeur de plantes évitées par les herbivores pour protéger les autres plantes et cultures. Pour tester les odeurs protectrices artificielles qu’ils ont élaboré, les chercheurs australiens ont utilisé le wallaby des marais, et se sont servis d’un arbuste désagréable, de la famille des agrumes, le Boronia pinnata, que les animaux herbivores exècrent. Ils ont ensuite choisi une espèce appréciée par l’animal, l’eucalyptus punctata, qu’ils ont aspergé d’une solution d’odeur artificielle de Boronia pinnata. Et les résultats ont montré que l’odeur seule était aussi efficace pour protéger les plants d’eucalyptus que la plante Boronia pinnata elle-même. La méthode fonctionne donc bien, et surtout plus longtemps qu’avec les répulsifs habituellement employés.
Les herbivores créent de nombreux dégâts sur certaines cultures, mais aussi sur des espèces végétales menacées. Or, si certaines plantes dégagent des odeurs qui les attirent, d’autres, à l’inverse, les font fuir. C’est sur ce constat que des chercheurs de l’université de Sydney ont publié les résultats de leur étude dans la revue « Nature Ecology & Evolution ». C’est cette faculté de repousser les animaux qui intéresse les scientifiques, car elle pourrait apporter une nouvelle solution à la protection de cultures essentielles pour l’alimentation humaine ou à la protection d’espèces menacées. Ils proposent donc une nouvelle méthode : recréer l’odeur de plantes évitées par les herbivores pour protéger les autres plantes et cultures. Pour tester les odeurs protectrices artificielles qu’ils ont élaboré, les chercheurs australiens ont utilisé le wallaby des marais, et se sont servis d’un arbuste désagréable, de la famille des agrumes, le Boronia pinnata, que les animaux herbivores exècrent. Ils ont ensuite choisi une espèce appréciée par l’animal, l’eucalyptus punctata, qu’ils ont aspergé d’une solution d’odeur artificielle de Boronia pinnata. Et les résultats ont montré que l’odeur seule était aussi efficace pour protéger les plants d’eucalyptus que la plante Boronia pinnata elle-même. La méthode fonctionne donc bien, et surtout plus longtemps qu’avec les répulsifs habituellement employés. A peine les portes du Salon de l'Agriculture étaient-elles refermées que la FNSEA faisait savoir, après « un rendez-vous manqué avec l'exécutif » que les actions sur le terrain allaient se poursuivre. « Sur le plan politique, les choses ne sont clairement pas terminées », a déclaré le président du syndicat, Arnaud Rousseau qui ajoute : « Après les promesses du gouvernement, les exploitants attendent des réalisations concrètes dans leur ferme. Même si la FNSEA n'appelle pas à une mobilisation nationale, chaque département garde l'initiative de pouvoir faire un certain nombre d'actions. Les braises sont brûlantes et rien n'est fini… ». Le syndicat a pris acte des nombreuses annonces du gouvernement, dont beaucoup vont dans le bon sens, mais attend des éléments précis sur la simplification et la compétitivité notamment, avant la présentation attendue à la fin de ce mois, d'une grande loi d'orientation agricole. Il est vrai que certaines déclarations ne sont pas très claires, notamment en termes de simplification, comme cette promesse du Premier ministre Gabriel Attal pour « un contrôle unique administratif annuel », initiative confirmée par les ministres intéressés, mais dénoncée par un certain nombre de corps de contrôle qui affirment que ce n'est pas possible. Pour le monde agricole, il y a donc un vrai décalage entre ce qui est dit au gouvernement et les représentants de l'administration. La pression sera donc maintenue jusqu'à ce que la profession prenne connaissance de ce contiendra le nouveau pacte européen...
A peine les portes du Salon de l'Agriculture étaient-elles refermées que la FNSEA faisait savoir, après « un rendez-vous manqué avec l'exécutif » que les actions sur le terrain allaient se poursuivre. « Sur le plan politique, les choses ne sont clairement pas terminées », a déclaré le président du syndicat, Arnaud Rousseau qui ajoute : « Après les promesses du gouvernement, les exploitants attendent des réalisations concrètes dans leur ferme. Même si la FNSEA n'appelle pas à une mobilisation nationale, chaque département garde l'initiative de pouvoir faire un certain nombre d'actions. Les braises sont brûlantes et rien n'est fini… ». Le syndicat a pris acte des nombreuses annonces du gouvernement, dont beaucoup vont dans le bon sens, mais attend des éléments précis sur la simplification et la compétitivité notamment, avant la présentation attendue à la fin de ce mois, d'une grande loi d'orientation agricole. Il est vrai que certaines déclarations ne sont pas très claires, notamment en termes de simplification, comme cette promesse du Premier ministre Gabriel Attal pour « un contrôle unique administratif annuel », initiative confirmée par les ministres intéressés, mais dénoncée par un certain nombre de corps de contrôle qui affirment que ce n'est pas possible. Pour le monde agricole, il y a donc un vrai décalage entre ce qui est dit au gouvernement et les représentants de l'administration. La pression sera donc maintenue jusqu'à ce que la profession prenne connaissance de ce contiendra le nouveau pacte européen...  - Aisne
- Aisne - Cantal
- Cantal - Vosges
- Vosges