Le livre explore toutes les facettes de cette chasse exigeante : les différentes techniques (à courre, à tir, à l'affût, de jour comme de nuit), le choix et le dressage des chiens, la lecture des traces, mais aussi l’approche historique et culturelle. Lanorville évoque avec admiration des figures tutélaires comme Gaston Phébus, Le Verrier de la Conterie ou Le Couteulx de Canteleu, inscrivant ainsi sa prose dans une longue tradition cynégétique. Il ne s’agit pas simplement d’un manuel, mais bien d’un récit d’expérience et de passion, où la nature devient théâtre, le chasseur acteur, et le gibier adversaire loyal. Dans une langue riche et sobre, Lanorville rend hommage au sanglier, qu’il considère comme un adversaire digne, courageux et rusé. 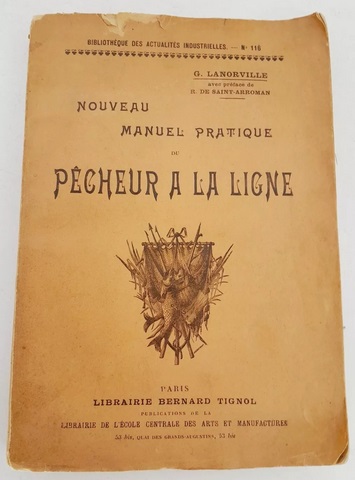 Il écrit : « La chasse au sanglier est de toutes la plus intense et la plus exaltante... ». Cette phrase pourrait, à elle seule, résumer l’esprit de tout le livre. Car il ne s’agit pas seulement de tuer, mais de comprendre, de traquer, de mesurer l’instinct de l’animal à celui de l’homme. Le livre détaille également les moments forts de la chasse en battue ou en traque, le rôle essentiel des chiens, souvent élevés dans la proximité du chasseur, et l’émotion du contact final. Tout y est : le frisson du petit matin, l’effervescence des forêts, le suspense des longues attentes, et la décharge d’adrénaline au moment de la levée.
Il écrit : « La chasse au sanglier est de toutes la plus intense et la plus exaltante... ». Cette phrase pourrait, à elle seule, résumer l’esprit de tout le livre. Car il ne s’agit pas seulement de tuer, mais de comprendre, de traquer, de mesurer l’instinct de l’animal à celui de l’homme. Le livre détaille également les moments forts de la chasse en battue ou en traque, le rôle essentiel des chiens, souvent élevés dans la proximité du chasseur, et l’émotion du contact final. Tout y est : le frisson du petit matin, l’effervescence des forêts, le suspense des longues attentes, et la décharge d’adrénaline au moment de la levée.
Du fusil à la fourchette
Mais l’œuvre de Lanorville ne s’arrête pas à la lisière du bois. L’auteur consacre également plusieurs pages à la préparation culinaire du gibier, véritable rituel de passage entre le terrain et la table. Pour lui, la chasse culmine dans le partage du mets : « Le sanglier, met rustique mais noble, honore la table des princes... ». Cette dimension gastronomique, trop souvent négligée dans les ouvrages techniques, fait de ce livre un ouvrage complet, célébrant le cycle entier de la chasse : nature, savoir-faire, culture et convivialité. Aujourd’hui, alors que la chasse suscite débats et interrogations, relire Georges Lanorville, c’est revenir à une vision humaniste et équilibrée de la pratique cynégétique.  À travers « Les chasses du sanglier », l’auteur nous rappelle qu’un bon chasseur est d’abord un homme de respect : du gibier, de la nature, et de la tradition. Il reste à découvrir ou redécouvrir ce livre, en parcourant ses pages avec le même souffle que celui du vent dans les branches, les bottes dans les feuilles, ou les aboiements des chiens dans la fraîcheur du matin...
À travers « Les chasses du sanglier », l’auteur nous rappelle qu’un bon chasseur est d’abord un homme de respect : du gibier, de la nature, et de la tradition. Il reste à découvrir ou redécouvrir ce livre, en parcourant ses pages avec le même souffle que celui du vent dans les branches, les bottes dans les feuilles, ou les aboiements des chiens dans la fraîcheur du matin...
Anecdotes de battues : le sel de la chasse
Pour clore cet hommage, comment ne pas évoquer quelques-unes des anecdotes truculentes que Lanorville émaille dans son livre, avec un sens certain de la narration . Ces histoires, parfois cocasses, souvent pleines de finesse, disent tout de la dimension humaine et théâtrale de la chasse.
La première nous plonge dans une battue hivernale, où un jeune chasseur trop zélé décide de tirer sur une « bête noire » surgie des broussailles… avant de réaliser qu’il vient de trouer la culotte du piqueux, lancé ventre à terre derrière le sanglier. Le piqueux s’en sort indemne, mais Lanorville conclut malicieusement : « Ce fut la seule prise du jour, mais elle valut bien un trophée, tant la peur changea de camp ».
Autre scène, autre ton : celle d’un vieux sanglier rusé qui, traqué depuis l’aube, parvient à traverser la ligne des fusils sans un coup de feu. Le lendemain, on retrouve sa voie, mais aussi une flasque de gnôle abandonnée dans une haie. Lanorville note, pince-sans-rire : « L’animal n’avait pas seulement déjoué les chiens, il avait flairé la gueule fumeuse du tireur. Voilà qui en dit long sur l’odorat du solitaire… et la discipline de certains postés ».
Enfin, une dernière touche d’humour nous est offerte par un rapprocheur, probablement pas mal dressé, mais incontestablement sans gêne... Il partit en chasse, non pas du sanglier, mais d’un panier de victuailles porté par le maître d’un relais. L’homme en perdit sa baguette, sa terrine et sa contenance, pendant que le chien « levait le pâté comme d’autres lèvent... la bête. Lanorville s’en amuse : « Le pique-nique fut plus agité que la traque elle-même. Seul le chien fut vraiment repu... ».
Ces saynètes, parfois absurdes, souvent tendres, rappellent que la chasse n’est pas qu’un art ou un sport, mais un théâtre vivant, imprévisible, où se mêlent bravoure, ruse, maladresse et éclats de rire. Georges Lanorville savait en saisir l’âme profonde, avec un œil complice et une plume pleine de sève.
