Plumitif de talent
Jean Lurkin débute donc sa carrière de journaliste dans la revue bruxelloise « Cassandre », et il tente sa chance, sans beaucoup de succès, dans les journaux de Paris. Mais quelle meilleure école que le journalisme pour écrire court et précis. C‘est là que le cueillera la guerre de 1914. Blessé sur le front allié, son évacuation sur la Bourgogne, puis ses relations lui procureront une vraie sinécure dans les bureaux de la préfecture de Saône et Loire. Employé au Service du ravitaillement civil dans ce pays de cocagne, il pousse l’art du « rond de cuir » au suprême degré, celui de paraître profondément occupé lorsque parait le chef, et distiller, goutte à goutte, savamment, le venin de la déception dans l’âme des malheureux qui venait lui demander un quelconque renseignement. A cette époque, malgré tout heureuse pour lui en dépit du déracinement, il plaint son frère, Abel, prisonnier et interné en Allemagne.
Propulsé au Secrétariat général du Livre Belge
 Dans l’entre deux-guerres, il fréquente les plus célèbres stands de tir aux pigeons des villégiatures huppées, que sont Deauville et Monaco. Il fraye avec un monde riche, s’y fait de nombreuses relations qui l’inviteront à chasser partout en France et en Europe. Il en tirera une délicieuse nouvelle, dans une langue digne de Voltaire, publiée dans le Chasseur Français de 1942. Il y marque son désintérêt distingué pour ce monde frelaté, loin des réalités. Avec son frère, il écrira, non pas à deux mains mais à deux fourchettes, des titres qui célèbrent la gastronomie française et les vins du terroir, « Sous les tonnelles des auberges de France » et « Mémoires de deux compagnons de route et de table ». Il y a échange de bonnes préfaces entre Georges Flament-Hennebique, écrivain cynégétique, et Lurkin. Dans sa nombreuse bibliographie, que faut-il retenir ? Dans « Physiologie de la chasse », Jean Lurkin se penche avec compassion sur le système nerveux et les réflexes de ses frères en Saint Hubert. Mais tous ces titres sont frappés du sceau de la dérision et de l’humeur décalé. « Dernières chasses en zig-zag », écrit en 1933, est une chronique des randonnées cynégético-gastronomiques, car la chasse commence toujours par un solide petit déjeuner dont il faut s’arracher avant le plaisir de croiser du gibier. Les « Dernières chasses de l’an 40 » évoquent tout autant les années 1940, supposé âge d’or digne des Romains. Le titre « Tiradors et zuratos » explique les deux catégories de porteurs de fusils, le valeureux et le raté. Toutes les œuvres de Lurkin sont sorties des presses des Editions de Saint Hubert, à Vervoz, timbrées de son sceau et illustrées d’une ramure de cerf.
Dans l’entre deux-guerres, il fréquente les plus célèbres stands de tir aux pigeons des villégiatures huppées, que sont Deauville et Monaco. Il fraye avec un monde riche, s’y fait de nombreuses relations qui l’inviteront à chasser partout en France et en Europe. Il en tirera une délicieuse nouvelle, dans une langue digne de Voltaire, publiée dans le Chasseur Français de 1942. Il y marque son désintérêt distingué pour ce monde frelaté, loin des réalités. Avec son frère, il écrira, non pas à deux mains mais à deux fourchettes, des titres qui célèbrent la gastronomie française et les vins du terroir, « Sous les tonnelles des auberges de France » et « Mémoires de deux compagnons de route et de table ». Il y a échange de bonnes préfaces entre Georges Flament-Hennebique, écrivain cynégétique, et Lurkin. Dans sa nombreuse bibliographie, que faut-il retenir ? Dans « Physiologie de la chasse », Jean Lurkin se penche avec compassion sur le système nerveux et les réflexes de ses frères en Saint Hubert. Mais tous ces titres sont frappés du sceau de la dérision et de l’humeur décalé. « Dernières chasses en zig-zag », écrit en 1933, est une chronique des randonnées cynégético-gastronomiques, car la chasse commence toujours par un solide petit déjeuner dont il faut s’arracher avant le plaisir de croiser du gibier. Les « Dernières chasses de l’an 40 » évoquent tout autant les années 1940, supposé âge d’or digne des Romains. Le titre « Tiradors et zuratos » explique les deux catégories de porteurs de fusils, le valeureux et le raté. Toutes les œuvres de Lurkin sont sorties des presses des Editions de Saint Hubert, à Vervoz, timbrées de son sceau et illustrées d’une ramure de cerf.
Un monde plein de facéties et de déconvenues
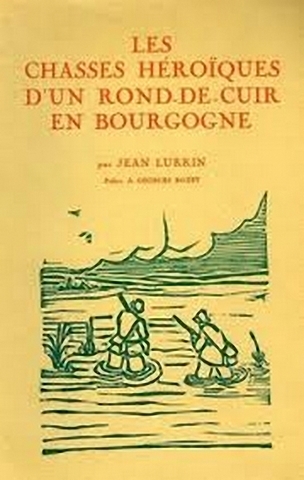 Voici notre chasseur, en 1917, sur les quais de Macon, à rêver d’occuper ses loisirs. Chasser, certes, mais il faut bien sûr, un compagnon à quatre pattes et un fusil. Mais quelle déception de constater qu’aucun sous-préfet interrogé ne connaissait les remises de gibier ! Heureusement, l’armurier local lui confie un calibre douze. Mais prudence absolue si l’on se trouve à quelque pas du « subrécargue qui tirait des salves de poudre noire à la chasse aux canards… Quant au chien, il avait l’avantage de montrer les caractéristiques, non pas d’une seule race, mais de plusieurs. Quelle aubaine d’avoir plusieurs chiens en un seul. D’ailleurs tous les chiens de nos chasseurs locaux ont des origines qui se perdaient dans les ténèbres des temps et des mésalliances… ». Enfin, ce grand moment de vérité, le jour de l’ouverture avec son ami Thomas. Lui, au moins, appartient au cercle des chasseurs, « fougueux, passionné, aimant le travail des chiens… », mais il ne peut le supporter « vêtu comme un trappeur de l’Arkansas, les fûts de ses jambes puissantes culottés de velours gris, et caparaçonnés de bottes à la canadienne, le corps à l’aise dans une veste de toile bise ample, aux poches multiples, un feutre gris aux ailes palpitantes sous la brise… ». Magnifique silhouette pourtant qui se termine par son glorieux retour au domicile « les oreilles et les pattes du lièvre encadrant à merveille son embonpoint… ». Dans un autre texte, le vétérinaire « est un Brummel par le haut et Jeannot par le bas… ». Le couple chien chasseur est au cœur de la communion : « voyez si c’est beau le travail de Diane » ou encore « Je passerai ma soirée à regarder ce chien » mais aussi « Mon chien arrête une bécasse, mon voisin la voit par terre et la met en joue. Je lève son fusil : ici, on chasse, on n’assassine pas ! ». Enfin, le chien peut également servir d’ambassadeur ironique si le chasseur expédie à son ennemi « un document scellé de trois petits pains à cacheter, ovales, de couleur bruyère, fournis par l’industrie naturelle de ces malheureuses petites bêtes ».
Voici notre chasseur, en 1917, sur les quais de Macon, à rêver d’occuper ses loisirs. Chasser, certes, mais il faut bien sûr, un compagnon à quatre pattes et un fusil. Mais quelle déception de constater qu’aucun sous-préfet interrogé ne connaissait les remises de gibier ! Heureusement, l’armurier local lui confie un calibre douze. Mais prudence absolue si l’on se trouve à quelque pas du « subrécargue qui tirait des salves de poudre noire à la chasse aux canards… Quant au chien, il avait l’avantage de montrer les caractéristiques, non pas d’une seule race, mais de plusieurs. Quelle aubaine d’avoir plusieurs chiens en un seul. D’ailleurs tous les chiens de nos chasseurs locaux ont des origines qui se perdaient dans les ténèbres des temps et des mésalliances… ». Enfin, ce grand moment de vérité, le jour de l’ouverture avec son ami Thomas. Lui, au moins, appartient au cercle des chasseurs, « fougueux, passionné, aimant le travail des chiens… », mais il ne peut le supporter « vêtu comme un trappeur de l’Arkansas, les fûts de ses jambes puissantes culottés de velours gris, et caparaçonnés de bottes à la canadienne, le corps à l’aise dans une veste de toile bise ample, aux poches multiples, un feutre gris aux ailes palpitantes sous la brise… ». Magnifique silhouette pourtant qui se termine par son glorieux retour au domicile « les oreilles et les pattes du lièvre encadrant à merveille son embonpoint… ». Dans un autre texte, le vétérinaire « est un Brummel par le haut et Jeannot par le bas… ». Le couple chien chasseur est au cœur de la communion : « voyez si c’est beau le travail de Diane » ou encore « Je passerai ma soirée à regarder ce chien » mais aussi « Mon chien arrête une bécasse, mon voisin la voit par terre et la met en joue. Je lève son fusil : ici, on chasse, on n’assassine pas ! ». Enfin, le chien peut également servir d’ambassadeur ironique si le chasseur expédie à son ennemi « un document scellé de trois petits pains à cacheter, ovales, de couleur bruyère, fournis par l’industrie naturelle de ces malheureuses petites bêtes ».
Plaisirs de la table
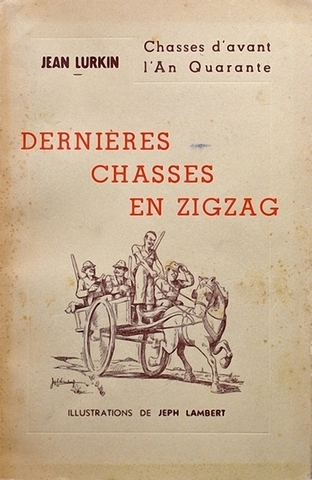 Parfois, au cours d’une sortie de chasse, Lurkin croise une « étonnante apparition, le dernier veneur du Mâconnais, échappé tout vivant des Gentilshommes Chasseurs, avec une barbe chenue taillée à la Henri IV, et un indiscutable grand air, nonobstant l’état de sa monture. En châtiment de quel péché, ce noble et mélancolique vieillard, après l’hallali de ses derniers rêves, menait-il de la sorte une interminable retraite au bronchement de sa jument éreintée, prêtant l’oreille, en vain, aux échos endormis des fanfares, jadis sonnées en ces forêts, par les joyeux contemporains de Foudras ». Et en conclusion de cette belle journée, c’est l’arrivée à l’auberge. Après le coup de fusil, attention à celui de l’aubergiste. Le dos au feu, voici que se déroule le menu : une belle poule au riz, trois livres de pot au feu, un jeune faisan rôti, un civet d’un lièvre adulte, le tout escorté de broutilles telles que lentilles, salades et autres. On peut aussi y trouver la soupe quinquette, ainsi nommée, cordial et reconstituant de premier ordre, très apprécié de la masse des chasseurs et des soldats, faite d’une fondue de sucre sur une tranche de pain bis large, la plus arrosée possible de vin. Pour le breuvage, que de choix dans les crus du Mâconnais qui ne se consomment qu’en pot. Surtout il faut laisser le noah, ce petit vin aigre et suret, cette piquette que tout mâconnais affecte de dédaigner, comme si elle était indigne de son palais subtil, et qu’il abandonne aux « ventres jaunes » ces habitants de la Bresse, région sans vigne. Parfois, c’est un menu de guerre qui orne la table familiale de Lurkin, « un corbeau dont la tête trop suggestive avait été tranchée. Le bouillon était amer et trouble, ainsi que les remords d’un péché capital. Le corneillard dressant dans la pénombre, sur son plat, une paire de pattes immenses, maigres et menaçantes. Dès cet instant, les rôles changèrent, le corbeau n’était plus la victime, mais bien au contraire, devenait notre bourreau… Ce repas se termine par une course éperdue vers les toilettes… ». Que d’agitation autour des tables, où plane l’ombre de Shéhérazade, magicienne des mirages du verbe. Et que penser de toutes ces rumeurs colportées par tous les représentants de commerce, entre la présence de loups à Ruffec et les milliers de francs, brûlés quotidiennement par le duc de Westminster, pour son vautrait landais. Mais, nous sommes en 1922…
Parfois, au cours d’une sortie de chasse, Lurkin croise une « étonnante apparition, le dernier veneur du Mâconnais, échappé tout vivant des Gentilshommes Chasseurs, avec une barbe chenue taillée à la Henri IV, et un indiscutable grand air, nonobstant l’état de sa monture. En châtiment de quel péché, ce noble et mélancolique vieillard, après l’hallali de ses derniers rêves, menait-il de la sorte une interminable retraite au bronchement de sa jument éreintée, prêtant l’oreille, en vain, aux échos endormis des fanfares, jadis sonnées en ces forêts, par les joyeux contemporains de Foudras ». Et en conclusion de cette belle journée, c’est l’arrivée à l’auberge. Après le coup de fusil, attention à celui de l’aubergiste. Le dos au feu, voici que se déroule le menu : une belle poule au riz, trois livres de pot au feu, un jeune faisan rôti, un civet d’un lièvre adulte, le tout escorté de broutilles telles que lentilles, salades et autres. On peut aussi y trouver la soupe quinquette, ainsi nommée, cordial et reconstituant de premier ordre, très apprécié de la masse des chasseurs et des soldats, faite d’une fondue de sucre sur une tranche de pain bis large, la plus arrosée possible de vin. Pour le breuvage, que de choix dans les crus du Mâconnais qui ne se consomment qu’en pot. Surtout il faut laisser le noah, ce petit vin aigre et suret, cette piquette que tout mâconnais affecte de dédaigner, comme si elle était indigne de son palais subtil, et qu’il abandonne aux « ventres jaunes » ces habitants de la Bresse, région sans vigne. Parfois, c’est un menu de guerre qui orne la table familiale de Lurkin, « un corbeau dont la tête trop suggestive avait été tranchée. Le bouillon était amer et trouble, ainsi que les remords d’un péché capital. Le corneillard dressant dans la pénombre, sur son plat, une paire de pattes immenses, maigres et menaçantes. Dès cet instant, les rôles changèrent, le corbeau n’était plus la victime, mais bien au contraire, devenait notre bourreau… Ce repas se termine par une course éperdue vers les toilettes… ». Que d’agitation autour des tables, où plane l’ombre de Shéhérazade, magicienne des mirages du verbe. Et que penser de toutes ces rumeurs colportées par tous les représentants de commerce, entre la présence de loups à Ruffec et les milliers de francs, brûlés quotidiennement par le duc de Westminster, pour son vautrait landais. Mais, nous sommes en 1922…
Lisez Lurkin
Selon Lurkin, la France était le paradis des chasseurs. « Deux cents bécasses sont parties de Sanguinet pour Bordeaux, toutes tirées depuis six jours, et du côté de Royan, c’est une invasion d’alouettes… ». Mais le chasseur local se ferme comme une huitre devant les questions du chasseur étranger. « Avez-vous encore du sanglier dans le bois de Goulène ? Un silence mortel s’établit, les moustaches se figèrent, la température baissa subitement de 10°, le boucher avait un bœuf sur la langue…». Le tableau final, qu’il condamne dans les tirs aux pigeons, n’est pas la motivation du vrai chasseur. « Ce qu’il aimait dans la chasse, c’était le spectacle des choses, la promenade sous un ciel changeant comme son âme puérile… ». Même après une journée de bredouille, Lurkin vous fera rire de votre déveine. Alors à lire et relire, car « Lorsqu‘il eût fait un brin d’ivoire du dernier ossement de l’oiseau royal, il releva la tête… » Sucez donc jusqu’à la moelle les textes de Lurkin, ils vous nourriront de promesses de chasses inoubliables.
Extrait : Oies et poules d’eau
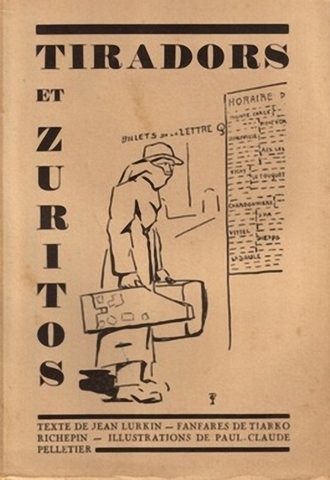 Il était bien entendu que cette chasse constituait surtout le motif de promenade de santé. Nous nous engageâmes dans les champs, après les dernières maisons du faubourg. La neige avait à peu près disparu, mais le froid était encore vif. Nous perdîmes tout espoir de trouver quelque chose en nous apercevant que deux chasseurs et trois pêcheurs nous y avaient précédés, ce qui nous fournit l’occasion de remarquer sévèrement combien, il y a, pendant la semaine, de gens qui n’ont rien à faire. Nous voulions traverser la Grosne par la petite passerelle qui la surmonte à son embouchure, mais la crue des derniers jours l’ayant emportée, nous dûmes revenir sur nos pas vers Mâcon. Il se confirmait de plus en plus que notre sortie serait une promenade hygiénique. Néanmoins, nous convînmes de passer de l’autre côté de la Saône par le pont de chemin de fer, et de faire un bref circuit dans les prairies inondées de la Bresse. Nous battions depuis une heure et mollement, parce que sans résultat, les fossés avoisinant le talus de la voie ferrée, quand l’impérissable Diane, donnant les signes de l’intérêt le plus aigu, pénétra dans un buisson, où Top la rejoignit. Leurs efforts combinés mirent à l’essor une poule d’eau qui essuya brillamment mes deux coups de feu tirés cependant avec soin, mais par derrière. Je me rappelais, sans que ce fut une consolation suffisante, ces deux lignes d’un livre de chasse que je feuilletais la veille au soir : la poule d’eau vole plus vite qu’il y parait. Souvent, le chasseur est trompé par sa lourdeur apparente et tire trop tard. Thomas et Champommier avaient, suivant leur habitude, le fusil au dos pour rouler une cigarette, ce qui fit dire à Gallois, quand nous lui racontâmes l’incident, qu’à la chasse, il fallait fumer des cigarettes toutes préparées. Mais la poule d’eau n’était pas sauve pour avoir échappé à mes seules foudres. Ayant repéré l’endroit où elle s’était remise, nous l’y poursuivîmes. Elle se leva dans les culottes, d’ailleurs élégantes, de Champommier, qui brûla deux cartouches. Afin de retraverser la Veyle, elle me passa ensuite en plein travers. Bien que je me rappelasse éperdument le précepte du vieux bouquin cynégétique, je la manquai encore et de mes deux décharges. L’odeur de la poudre nous avait enivrés. Nous nous précipitâmes de l’autre côté où nous avions vu nettement notre gibier s’abattre près d’un buisson. Plus lestes que moi, mes deux compagnons me devancèrent et, arrivés près du refuge de la pauvrette, la firent s’enlever.
Il était bien entendu que cette chasse constituait surtout le motif de promenade de santé. Nous nous engageâmes dans les champs, après les dernières maisons du faubourg. La neige avait à peu près disparu, mais le froid était encore vif. Nous perdîmes tout espoir de trouver quelque chose en nous apercevant que deux chasseurs et trois pêcheurs nous y avaient précédés, ce qui nous fournit l’occasion de remarquer sévèrement combien, il y a, pendant la semaine, de gens qui n’ont rien à faire. Nous voulions traverser la Grosne par la petite passerelle qui la surmonte à son embouchure, mais la crue des derniers jours l’ayant emportée, nous dûmes revenir sur nos pas vers Mâcon. Il se confirmait de plus en plus que notre sortie serait une promenade hygiénique. Néanmoins, nous convînmes de passer de l’autre côté de la Saône par le pont de chemin de fer, et de faire un bref circuit dans les prairies inondées de la Bresse. Nous battions depuis une heure et mollement, parce que sans résultat, les fossés avoisinant le talus de la voie ferrée, quand l’impérissable Diane, donnant les signes de l’intérêt le plus aigu, pénétra dans un buisson, où Top la rejoignit. Leurs efforts combinés mirent à l’essor une poule d’eau qui essuya brillamment mes deux coups de feu tirés cependant avec soin, mais par derrière. Je me rappelais, sans que ce fut une consolation suffisante, ces deux lignes d’un livre de chasse que je feuilletais la veille au soir : la poule d’eau vole plus vite qu’il y parait. Souvent, le chasseur est trompé par sa lourdeur apparente et tire trop tard. Thomas et Champommier avaient, suivant leur habitude, le fusil au dos pour rouler une cigarette, ce qui fit dire à Gallois, quand nous lui racontâmes l’incident, qu’à la chasse, il fallait fumer des cigarettes toutes préparées. Mais la poule d’eau n’était pas sauve pour avoir échappé à mes seules foudres. Ayant repéré l’endroit où elle s’était remise, nous l’y poursuivîmes. Elle se leva dans les culottes, d’ailleurs élégantes, de Champommier, qui brûla deux cartouches. Afin de retraverser la Veyle, elle me passa ensuite en plein travers. Bien que je me rappelasse éperdument le précepte du vieux bouquin cynégétique, je la manquai encore et de mes deux décharges. L’odeur de la poudre nous avait enivrés. Nous nous précipitâmes de l’autre côté où nous avions vu nettement notre gibier s’abattre près d’un buisson. Plus lestes que moi, mes deux compagnons me devancèrent et, arrivés près du refuge de la pauvrette, la firent s’enlever.
Cependant, quelque honte que j’en éprouve pour eux, je dois à la vérité qu’au reste, j’ai toujours scrupuleusement respecté de déclarer qu’ils lui consacrèrent en vain quatre nouvelles cartouches. Mais la poule d’eau avait une patte cassée et peut-être du plomb ailleurs. Elle s’éleva péniblement au-dessus du chemin de fer et je la vis baisser de l’autre côté du marais d’où nous l’avions délogée. Je l’y poursuivis et l’aperçus, blottie sur un glaçon à dix mètres du bord. Elle ne remuait que la tête et je songeai que, blessée, elle était sans doute dans l’impossibilité de reprendre son vol. N’ayant pas tiré le dernier, je jugeai qu’il ne m’appartenait pas de lui donner le coup de grâce et chevaleresquement, je hélai Champommier. Il se hâta. Lui ayant fait distinguer l’oiseau, je l’invitai à mettre promptement un terme à ses souffrances. Champommier, galant homme, se récusa. « C’est vous qui l’avez découverte, à vous de l’achever », « je n’en ferai rien », « mais c’est de vous qu’elle a reçu les premières atteintes », « non ! », « si ! ». Finalement, je l’emportai et Champommier tira, labourant la glace à un pied en avant de la poule d’eau qui salua du bec. Devant cet insuccès, je ne me fis plus prier et l’encadrai d’un coup de six, qui cependant ne l’anéantit pas encore. Pris de rage, Champommier la gratifia d’une dernière et décisive cartouche. Thomas qui nous observait de la prairie en contrebas, me parut fort réjoui de ces péripéties, demandant même avec un ricanement, s’il fallait aller nous chercher une boîte de cartouches à Mâcon. Dédaignant ces facéties trop aisées, nous nous concertions sur le moyen de nous emparer de notre trophée. La poule d’eau était bien morte cette fois, -on le serait à moins-, mais à dix mètres du bord, dans une eau froide parsemée de glaçons, d’où émergeaient quelques saules. Le marais, heureusement, était peu profond. Nous traînâmes dans l’eau des fagots qui se trouvaient à proximité et bientôt nous eûmes improvisé, en les mettant bout à bout, une sorte de chaussée élastique et peu sûre, mais qui nous rapprochait du gibier. Je sortis de mon sac la ficelle de Gallois, nous y attachâmes une bûche bien sèche et me risquant au bout de l’estacade, je réussis, en lançant ma bouée par-delà l’oiseau, à le ramener à moi. La joie du triomphe me fit perdre l’équilibre, et je ne pus éviter l’immersion fâcheuse de mes extrémités inférieures jusqu’aux genoux.
Et, je regrettai vivement de m’être donné tant de peine à transporter des fagots pour éviter un bain, alors que si j’avais connu les desseins de la fatalité, j’aurais pu entrer dans l’eau tout de suite. J’éprouvai néanmoins quelque satisfaction à voir Top, lorsque le cadavre de la poule d’eau, par le moyen de la bûche, s’approcha de la rive, se jeter à l’eau et l’aller prendre délicatement entre ses crocs pour revenir la déposer sur le sol ferme. Jamais, je ne lui avais appris ou même indiqué le rapport. Son instinct de chien lui disait qu’il y avait encore dans cette voie une mission utile à remplir, mais il n’en sentait toutefois l’urgence que lorsqu’il voyait son maître dans l’impossibilité absolue d’atteindre le gibier. Il est évident que, agile et infatigable comme il l’était, il ne songeait pas à me rendre le même service quand la pièce de gibier tombait en pleine terre, à n’importe quelle distance que ce fût. Il devait songer alors « mais c’est pour lui une fatigue insignifiante que de l’aller cueillir. Je n’ai nul besoin de me déranger ». Je me promis bien de cultiver, quand j’en aurai le loisir, ces précieuses dispositions et de faire de Top, qui était déjà un chercheur et un trouveur de qualité, un excellent retriever. Champommier caressait la poule d’eau avec un plaisir non équivoque. Elle n’avait de blessure apparente qu’un plomb à la tête, un à la patte et l’autre à l’aile. Une lutte violente, quoique toujours courtoise, s’engageait ente Championnet et moi sur le point de savoir qui emporterait notre poule d’eau. Je puis dire notre, car nos coups de fusils, nos tentatives pour l’abattre d’abord, pour la ramasser ensuite, avaient été à peu près également efficaces. On n’eût pu dire que difficilement du point de vue du droit strict, à qui elle devait échoir. Je sortis vainqueur de ce tournoi d’amabilité où j‘avais été d’autant plus persuasif que le souvenir du précédent rôti de foulque me donnait encore la nausée. Eût-il été question d’un oiseau plus comestible que la poule d’eau, d’une bécasse par exemple, il y aurait eu certainement aussi une discussion entre nous, mais je ne veux pas vous jurer qu’au lieu de nous jeter réciproquement à la tête l’objet litigieux, nous ne l’eussions pris par chacun par une patte pour tirer à nous avec l’énergie de la convoitise. L’enthousiasme un peu calmé, nous fîmes le compte de ce que la bestiole nous coûtait, nullement par avarice comme bien on le pense, mais par curiosité. Ça en valait la peine : treize cartouches à 12 sous pièce, soit huit francs quatre vingts. La livre de poule d’eau nous revenait à environ 18 francs. Champommier me fit remarquer alors que le caviar et les truffes étaient plus économiques…
