A quoi tient une carrière artistique…
Cette carrière, après la guerre de 1914 qu’il fait comme infirmier, sera longue à éclore. Il peint agréablement et fignole des maquettes de bateaux. Il plonge dans les archives des La Varende, famille de conteurs, et de son grand-père dont il était l’auditeur préféré. Son premier succès vient en 1933, avec « Pays d’Ouche », dont le duc de Broglie, de l’Académie Française, signe la préface. Ensuite, s’enchaînent les succès de librairie, comme « Nez de cuir » (1936), porté au cinéma par Allégret, avec Jean Marais dans le rôle principal. Avec « Le centaure de Dieu », couronné par l’Académie Française en 1938, son œuvre en fait l’héritier des grandes plumes normandes, tel Flaubert, Maupassant et Barbey d’Aurevilly. Aussi, il ne faut pas trop le cantonner dans une littérature de défense des archaïsmes de la province française. Jean de La Varende décèdera loin de sa chère Normandie, à Paris, d’un infarctus du myocarde, et sa dépouille retrouvera, dans son village de Chamblac, cette terre d’Ouche, si pauvre, cette « Crau » normande, cette rude terre qui voisine la plantureuse vallée d’Auge.
Une riche bibliographie
 Elle est aussi longue que son patronyme et tient sur plusieurs pages : vingt romans, une dizaine de biographies de marins et de personnages historiques, des centaines de nouvelles. Mais ses romans sont toujours centrés sur son terroir normand, où la nature entre par toutes les lignes de vie. Il faut donc sélectionner les quelques textes sur la chasse et la vènerie, pour les décortiquer. Enfant, il fut instruit par la meilleure école, celle de la nature. Avec ses petits amis paysans, il tâte les fruits sans appréhension, tire sur la carotte sauvage sans crainte de la cigüe. Il grappille épis, églantines et mûres, selon la rotation des saisons. Ne s’est-il pas dépeint dans ce portrait du commandeur de Galart : « s’enfoncer dans le hallier, dans les bois touffus, serrés comme feutre… Pour le suivre, seuls les petits paysans tiraient parti de sa ruse et de son adresse. Il chassa avant de savoir ses prières, avec la passion de poursuivre et de tuer. A dix ans, il prit son premier blaireau. Le taciturne savait tous les cris d’animaux, leurs expressions et il piégeait avec génie. Il devint blême quand on lui permit un fusil. Jamais, il ne ramenait ses dépouilles. Il les donnait, après les avoir longuement considérées et maniées… ». Tout est dit : être animal au milieu des animaux, prédateur sans haine, tel fut son destin.
Elle est aussi longue que son patronyme et tient sur plusieurs pages : vingt romans, une dizaine de biographies de marins et de personnages historiques, des centaines de nouvelles. Mais ses romans sont toujours centrés sur son terroir normand, où la nature entre par toutes les lignes de vie. Il faut donc sélectionner les quelques textes sur la chasse et la vènerie, pour les décortiquer. Enfant, il fut instruit par la meilleure école, celle de la nature. Avec ses petits amis paysans, il tâte les fruits sans appréhension, tire sur la carotte sauvage sans crainte de la cigüe. Il grappille épis, églantines et mûres, selon la rotation des saisons. Ne s’est-il pas dépeint dans ce portrait du commandeur de Galart : « s’enfoncer dans le hallier, dans les bois touffus, serrés comme feutre… Pour le suivre, seuls les petits paysans tiraient parti de sa ruse et de son adresse. Il chassa avant de savoir ses prières, avec la passion de poursuivre et de tuer. A dix ans, il prit son premier blaireau. Le taciturne savait tous les cris d’animaux, leurs expressions et il piégeait avec génie. Il devint blême quand on lui permit un fusil. Jamais, il ne ramenait ses dépouilles. Il les donnait, après les avoir longuement considérées et maniées… ». Tout est dit : être animal au milieu des animaux, prédateur sans haine, tel fut son destin.
Le chantre de la chasse et des côtes normandes
Interprète des futaies de Normandie, son œuvre nous intéresse au plus haut point, car elle s’étale sur plusieurs décennies. Si la partie strictement cynégétique se concentre dans de rares éditions de luxe et de petit tirage (« Chassez-vous avec Bois de Jusserat ? » ; « Chasse à courre » ; « Vènerie » ; « Contes de Vènerie »), c’est tout au long de ces ouvrages que la chasse irrigue ses écrits. Lire La Varende, c’est retrouver le même bonheur que celui ressenti par le chasseur : « le jour s’était passé dans une telle sensation de bien-être continu, que chaque minute vous frappait de bonheur comme un écho qui vous revient… ». Mais ce fragile bonheur peut éclater comme un accident de chasse : « le chien tirait à plein trait, et ce ne fut pas long. A quelques trois cents mètres de la maison forestière, l’abbé distingua sur le sol de neige, une chose sombre étalée. Des gémissements en venaient… ». Le chien de sang retrouve, non pas le gibier, mais le chasseur, car dès le départ de la scène, « les chiens avaient tout de suite réagi et continuaient d’aboyer ». Le chasseur sort par tous les temps et sur tous les terrains, et l’on s’interroge sur ses randonnées : « comment avait-il pu gagner la maison forestière, sur ce terrain ? Il était, 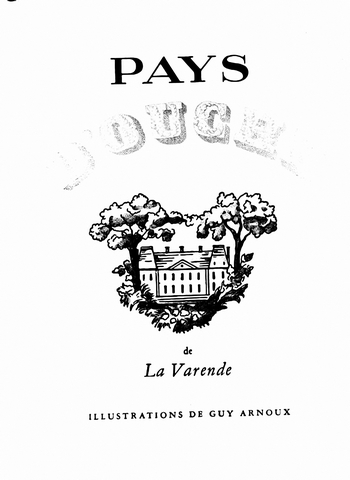 sans doute, un de ces chasseurs endurcis, que rien n’arrête dans leurs promenades… ». Si le vieux français utilise le même mot « déduit », pour l’amour et la chasse, c’est qu’il y a piste amoureuse, émoi, foudroiement et prise. Le chasseur va donc utiliser les mêmes ruses qu’à la chasse pour débusquer les amours de sa femme. Dans le chapitre « Un amour » (les Gentilshommes), le garde, grisonnant, s’était marié avec une jeunette qui eût pu être sa fille. « Il la regarde comme un jeune chevreuil bondissant, et l’acuité de son regard perce la poche de fiel de la jalousie. Pour lui comptaient les signes, et c’est par ces signes que toute son activité s’organisait. Une branche brisée lui indiquait, selon sa cassure, la hauteur de l’être qui venait de passer par là… Un matin, comme il faisait avec amour les sabots de sa jeune épouse, il remarqua, au bord de la semelle, une trace blanchâtre qui s’étendait, à peine visible. Il prit l’autre sabot, et sur celui–là, il comprit. Une tache avait été lavée ». Le drame se noue… Le garde cherchait les traces, car on ne fait le pied qu’au matin ou le soir, à jour frisant… Angéline avait donc traîné, car le talon s’était beaucoup enfoncé, tandis qu’à l’aller… Tanchebraye tirait l’image de sa jeune femme aussi nettement qu’il restituait la taille d’une biche et même son aspect. Il la vit partir, légère par l’envie d’arriver, puis revenir alourdie, reprise par la disgrâce. La chasse se déporte ainsi dans la vie de tous les jours, lien vertical où chacun doit être digne de son rôle.
sans doute, un de ces chasseurs endurcis, que rien n’arrête dans leurs promenades… ». Si le vieux français utilise le même mot « déduit », pour l’amour et la chasse, c’est qu’il y a piste amoureuse, émoi, foudroiement et prise. Le chasseur va donc utiliser les mêmes ruses qu’à la chasse pour débusquer les amours de sa femme. Dans le chapitre « Un amour » (les Gentilshommes), le garde, grisonnant, s’était marié avec une jeunette qui eût pu être sa fille. « Il la regarde comme un jeune chevreuil bondissant, et l’acuité de son regard perce la poche de fiel de la jalousie. Pour lui comptaient les signes, et c’est par ces signes que toute son activité s’organisait. Une branche brisée lui indiquait, selon sa cassure, la hauteur de l’être qui venait de passer par là… Un matin, comme il faisait avec amour les sabots de sa jeune épouse, il remarqua, au bord de la semelle, une trace blanchâtre qui s’étendait, à peine visible. Il prit l’autre sabot, et sur celui–là, il comprit. Une tache avait été lavée ». Le drame se noue… Le garde cherchait les traces, car on ne fait le pied qu’au matin ou le soir, à jour frisant… Angéline avait donc traîné, car le talon s’était beaucoup enfoncé, tandis qu’à l’aller… Tanchebraye tirait l’image de sa jeune femme aussi nettement qu’il restituait la taille d’une biche et même son aspect. Il la vit partir, légère par l’envie d’arriver, puis revenir alourdie, reprise par la disgrâce. La chasse se déporte ainsi dans la vie de tous les jours, lien vertical où chacun doit être digne de son rôle.
« Passe-pieds vifs et dégourdis »
Plus tard, Tanchebraye, écœuré, démissionna de l’équipage Chaudesaigues, car le maître d’équipage, sans dague, lui refusa de servir l’animal. « Nom de nom, faire servir, à une Saint-Hubert, un dix-cors tanné, par un valet armé d’un couteau lié à une perche… ». Dans ce monde de fureur, de cris, mais aussi d’élégance, nous croisons de bien curieux personnages : « … un vieux piqueur en livrée verte, ceinturon et couteau de chasse, culottes de peau blanche, bottes à revers. Une énorme cicatrice tendue de la joue au menton lui faisait quatre lèvres… ». Le risque tient donc la balance à égalité entre l’homme et l’animal : « Si vous croyez qu‘il fait bon devant un vieux solitaire aux défenses longues comme ça, qui décousait des chiens en baudruche. Ça vous remonte  la braguette… Et quand la guerre vous confisque votre arsenal, il ne vous reste que la tenderie. Il faut savoir fabriquer des gluaux avec des écorces de houx fraîches et de la gomme de cerisier. On forme un mucilage, qui après une longue réduction à feu doux, donne une poix invraisemblablement collante… ». . Et de se réjouir de voir les becs droits se coincer dans les cornets appâtés. Parfois, dans son style, refleurissent des tournures aimablement archaïques. La Varende réussit à maintenir à fleur de plume le monde qui nous intéresse. Il sait déchirer le rideau vert de la nature pour nous entraîner dans son dialogue. Et la chasse est musique, puisque les fanfares sont des « passe-pieds vifs et dégourdis ». Petit manque dans son œuvre : le chien. Pas d’action de meutes, juste des descriptions statiques de chenil : « Le marquis alla jusqu’au chenil qu’on plaçait assez loin de l’habitation à cause des abois de la meute, et de ses interminables invocations à Phoebé, qui ne s’arrêtent parfois qu’au petit jour. Les nuits de pleine lune sont célébrées dans les chenils par ces étranges supplications désolées, que les chiens les plus paisibles ne peuvent retenir… ». Ici plus de silence, plus de bouderie. C’étaient des tendresses à déborder, des trémolos de gorge, des torsions frénétiques. Tous les chiens appuyés sur le mur de leur fosse l’appelaient, le saluaient, montaient les uns sur les autres pour se rapprocher de lui, de sorte qu’en avançant, le maître entraînait une vague, un petit mascaret tricolore au bord de la cavité. Il repartit chercher des croûtes. Grâce au chien, nul ne peut douter que l’amour et l’affection ne soient aussi forts que la faim et la soif. C’est la bête qui prouve le mieux le plus bel apanage de la nature, le don de soi. Il aime ces chiens dont « la queue formait des faucilles claires. Ils avaient des oreilles interminables et comme des taches de peinture noire et jaune sur leur rude poil blanc ». Mais son grand art reste l’évocation, par l’oreille, quand il évoque la rumeur marine des chiens. « Les dames sont restées au château, mais, de la terrasse, elles suivent toutes les péripéties de la chasse. Hélène écoutait les abois qui paraissaient un chantonnement de la forêt, un chant allègre à bouche close. Elles revoyaient Tanchebraye dégainer, sourire, s’avancer dans le silence général, puis comme la foudre, scintiller et frapper. Hallali par terre… Déjà caressante et presque ironique, la Calèche des Dames leur annonçait l’arrivée de leur jolies rivales… ».
la braguette… Et quand la guerre vous confisque votre arsenal, il ne vous reste que la tenderie. Il faut savoir fabriquer des gluaux avec des écorces de houx fraîches et de la gomme de cerisier. On forme un mucilage, qui après une longue réduction à feu doux, donne une poix invraisemblablement collante… ». . Et de se réjouir de voir les becs droits se coincer dans les cornets appâtés. Parfois, dans son style, refleurissent des tournures aimablement archaïques. La Varende réussit à maintenir à fleur de plume le monde qui nous intéresse. Il sait déchirer le rideau vert de la nature pour nous entraîner dans son dialogue. Et la chasse est musique, puisque les fanfares sont des « passe-pieds vifs et dégourdis ». Petit manque dans son œuvre : le chien. Pas d’action de meutes, juste des descriptions statiques de chenil : « Le marquis alla jusqu’au chenil qu’on plaçait assez loin de l’habitation à cause des abois de la meute, et de ses interminables invocations à Phoebé, qui ne s’arrêtent parfois qu’au petit jour. Les nuits de pleine lune sont célébrées dans les chenils par ces étranges supplications désolées, que les chiens les plus paisibles ne peuvent retenir… ». Ici plus de silence, plus de bouderie. C’étaient des tendresses à déborder, des trémolos de gorge, des torsions frénétiques. Tous les chiens appuyés sur le mur de leur fosse l’appelaient, le saluaient, montaient les uns sur les autres pour se rapprocher de lui, de sorte qu’en avançant, le maître entraînait une vague, un petit mascaret tricolore au bord de la cavité. Il repartit chercher des croûtes. Grâce au chien, nul ne peut douter que l’amour et l’affection ne soient aussi forts que la faim et la soif. C’est la bête qui prouve le mieux le plus bel apanage de la nature, le don de soi. Il aime ces chiens dont « la queue formait des faucilles claires. Ils avaient des oreilles interminables et comme des taches de peinture noire et jaune sur leur rude poil blanc ». Mais son grand art reste l’évocation, par l’oreille, quand il évoque la rumeur marine des chiens. « Les dames sont restées au château, mais, de la terrasse, elles suivent toutes les péripéties de la chasse. Hélène écoutait les abois qui paraissaient un chantonnement de la forêt, un chant allègre à bouche close. Elles revoyaient Tanchebraye dégainer, sourire, s’avancer dans le silence général, puis comme la foudre, scintiller et frapper. Hallali par terre… Déjà caressante et presque ironique, la Calèche des Dames leur annonçait l’arrivée de leur jolies rivales… ».
Marin des terres
Deux associations, « Amis de La Varende » et « Présence de La Varende », maintiennent, par leurs activités, la valeur et la modernité de ce « marin des terres ». Le duc de Brissac, grand fusil et grand veneur, adoube La Varende dans le cercle des écrivains de chasse : « Il fouette ses phrases comme un toupillon, jusqu’à ce qu’elles ronflent… ». Alors, plongeons, nous aussi, dans le monde des forêts enchantées de Jean de La Varende
Extrait
« Une histoire vraie, qui met en scène des gens comme j’en ai connu dans mon enfance : un père et ses deux fils, tous trois chasseurs chassant… », telle fut la présentation du duc de Brissac
« …A chevaucher, sonner fanfare, appeler les chiens, servir aux abois, en tout temps et toute lande, le père, digne gentilhomme, finit par rendre son âme à Dieu (qui en fut sans doute embarrassé, mais là n’est pas mon propos). On inhuma le patriarche, ses deux fils menaient le deuil. Quant à la suite de l’histoire…
Les trois Fromentée dont nous nous occuperons, étaient vraiment des gens de qualité. Ils avaient affiné un équipage de cerf, et c’est un travail de dix ans, dont il faut mieux ne pas parler si l’on veut terminer l’histoire… Les voilà donc partis au début de l’hiver par un bon novembre bien quiet, bien silencieux, qui porte superbement la voix des meutes dans son immense vide gris, qui semble à la fois filtrer et relancer les abois à travers les arbres nus, compliqués comme des étamines et nerveux comme des ressorts. Ils avaient quitté leur brave petit château où sagement, ils achevaient de grignoter un patrimoine qu’aucun n’avait pensé à augmenter, jamais. Le père et les fils commençaient la randonnée des châteaux amis et des chasses à courre, durant lesquelles le luxe et la bonne chère reparaissaient, quitte à se serrer le ventre une fois qu’on a passé la main…
Revenant bon train, en traversant une ligne, le fils ainé vit, juste comme dans une longue vue, un cheval bien ramassé qu’on ramenait en main. Il le reconnut tout de suite, quoiqu’il fût à six cents mètres, et se sentit très inquiet. Pour que le vieux La Fromentée eût abandonné, un jour où sa meute donnait… Le vieillard était très mal. Il souffrait, luttait, et l’on sentait en lui une angoisse de l’être physique entier, si l’être immatériel tenait encore et méprisait l’avertissement. « Peuh, ça ne va pas très fort… » Et le médecin ne fut pas rassurant. A trois heures du matin, le maître de maison, secrètement prévenu, avait fait chercher le prêtre. Le vieillard faiblissait dans une agonie difficile, mais toujours : « Qu’on ne change rien, que nos chiens chassent… ». Et l’équipage partit, parce que la chasse n’attend pas. Le cadet s’en fut au village chercher un menuisier qui pouvait vite lui fournir un cercueil provisoire. On ramènerait le vieil homme à sa bicoque, à son petit cimetière, en face de la plaine et à l’orée forestière, près de son père, de sa mère, de sa femme, pas bien loin de ses chiens que l’on avait placés tout près des hommes et presque en terre bénite. Ils se mirent en route dès le petit jour. On n’a pas le droit de faire voyager un corps mort, à moins de mobiliser toutes les administrations du royaume. On dissimule donc le cercueil, le brave et honnête cercueil de chêne qu’ils avaient fait venir la veille. On l’enfonça dans le coffre du dog-cart. Ainsi passait-il sous le siège, dont ses deux extrémités étaient garnies, masquées par des selles, des couvertures, et du foin qu’on emportait, sous prétexte de donner la botte aux chevaux. Le temps se maintenait, une aube frigide et vive rosissait les bois. C’était un véritable cortège. Le dog-cart s’en allait au pas, avec deux chevaux en tandem, dont le cheval du mort en tête, tout sellé. Les grandes trompes étaient, en signe de repos, accrochées aux lanternes de la voiture, avec les couteaux de chasse et les ceinturons.
Alors survint l‘aventure…
 Il y eut soudain une agitation frémissante de toute la meute qui fit face d’un seul mouvement. Quelque chose venait, grand train. Les hommes furent débordés. Un cerf arrivait, qui franchit la route en deux bonds, un daguet, membru et vif. La meute le suivit. Ce fut imparable. « Arrête, arrête ! Au cout’ là-haut ! Arrête-moi ça, prends les devants, les grands devants… ». Ah, que cela ronflait donc et revenait fort, régulier comme une mécanique vocale. On sentait que les trente chiens en avaient plein la truffe, que tout venait d’une seule gueule… L’aîné frappa doucement sur le cercueil : « Hein père, murmura-t-il très bas à cause du petit valet qui aurait pu l’entendre, l’ont-ils bien empaumé la voie, nos chiens. Entendez-vous ? Je reconnais Clairaut et Fricasse, toujours en tête. Bon Dieu, nos gens qui se mettent à sonner. C’est Jacques ! Ils ont la menée trop belle. Père, il faut leur pardonner… ». L’oreille tendue, l’esprit en effervescence, le veneur était grimpé debout sur son siège, et il accompagnait le courre de ses hommes et de ses chiens, dans un effort précis d’imagination… Mais la chasse ne pouvait passer ainsi, loin d’eux, hors d’eux. Il ne résista plus : « Père, je vous emmène ! ». L’étrange corbillard s’en alla par les layons, lentement, toujours car l’aîné n’eut point voulu changer l’allure processionnelle. Et il était sûr de son affaire. Il savait ses chemins les uns à la suite des autres… Il parlait au mort, lui redisait non plus ses excuses (il ne pensait déjà plus à s’excuser) mais ses explications… Pour lui persistait une émanation absolument caractéristique qui était celle de cet homme-là, qu’il aimait d’une sorte d’animalité. Sa tendresse ne s’éteignait pas, et par-là même durerait l’âme secrète. « Je suis certain, père, qu’il débouchera devant la Descente aux Charretiers… ». Les sonneries continuaient à le renseigner. De temps à autres, il s’adressait au vieillard et lui demandait son avis, et il recevait absolument, distinctement, un conseil. C‘est ainsi qu’ils comprirent que le bat-l’eau devenait moins probable, qu’on devait s’enfoncer plus au sud… Après une brève invocation, Paul prit le layon et descendit vers le remblai. Vu juste ! La chasse revenait par-là, pas de doute. Mais, craignant de se voir devancé, il crut possible de presser l’allure. On ne pouvait faire manquer à Monsieur Père son dernier hallali. Ils s’en allèrent donc au trot rapide et joli des deux chevaux en tandem, l’aîné plaçait son dog-cart comme s’il eût voulu gagner une gageure. C’est ici qu’il fut extraordinaire. Il se surpassa, devint voyant. Il était avec eux et sa double-vue le mettait devant les chiens. Il devinait tout, les défauts, les hourvaris, les changes, et il les résolvait. Si juste qu’en tournant soudain au grand trot, il vit au loin passer le daguet sur ses fins traînant la jambe, tandis que le tonnerre de la meute approchait. Ils débouchèrent, Jacques au cul des chiens. Jacques cria d’orgueil et de contentement, l’aîné était vraiment incomparable. « Bravo, Père ! » hurla le cadet en fonçant encore, tandis que son frère avait fort à faire pour empêcher son attelage de prendre le mors aux dents. Le cheval de tête faisait seul quelques foulées de galop, mais la voiture volait, justement lancée sur une allée de rendez-vous qui permettait la vitesse, entrainant tout le monde vers le rond-point…
Il y eut soudain une agitation frémissante de toute la meute qui fit face d’un seul mouvement. Quelque chose venait, grand train. Les hommes furent débordés. Un cerf arrivait, qui franchit la route en deux bonds, un daguet, membru et vif. La meute le suivit. Ce fut imparable. « Arrête, arrête ! Au cout’ là-haut ! Arrête-moi ça, prends les devants, les grands devants… ». Ah, que cela ronflait donc et revenait fort, régulier comme une mécanique vocale. On sentait que les trente chiens en avaient plein la truffe, que tout venait d’une seule gueule… L’aîné frappa doucement sur le cercueil : « Hein père, murmura-t-il très bas à cause du petit valet qui aurait pu l’entendre, l’ont-ils bien empaumé la voie, nos chiens. Entendez-vous ? Je reconnais Clairaut et Fricasse, toujours en tête. Bon Dieu, nos gens qui se mettent à sonner. C’est Jacques ! Ils ont la menée trop belle. Père, il faut leur pardonner… ». L’oreille tendue, l’esprit en effervescence, le veneur était grimpé debout sur son siège, et il accompagnait le courre de ses hommes et de ses chiens, dans un effort précis d’imagination… Mais la chasse ne pouvait passer ainsi, loin d’eux, hors d’eux. Il ne résista plus : « Père, je vous emmène ! ». L’étrange corbillard s’en alla par les layons, lentement, toujours car l’aîné n’eut point voulu changer l’allure processionnelle. Et il était sûr de son affaire. Il savait ses chemins les uns à la suite des autres… Il parlait au mort, lui redisait non plus ses excuses (il ne pensait déjà plus à s’excuser) mais ses explications… Pour lui persistait une émanation absolument caractéristique qui était celle de cet homme-là, qu’il aimait d’une sorte d’animalité. Sa tendresse ne s’éteignait pas, et par-là même durerait l’âme secrète. « Je suis certain, père, qu’il débouchera devant la Descente aux Charretiers… ». Les sonneries continuaient à le renseigner. De temps à autres, il s’adressait au vieillard et lui demandait son avis, et il recevait absolument, distinctement, un conseil. C‘est ainsi qu’ils comprirent que le bat-l’eau devenait moins probable, qu’on devait s’enfoncer plus au sud… Après une brève invocation, Paul prit le layon et descendit vers le remblai. Vu juste ! La chasse revenait par-là, pas de doute. Mais, craignant de se voir devancé, il crut possible de presser l’allure. On ne pouvait faire manquer à Monsieur Père son dernier hallali. Ils s’en allèrent donc au trot rapide et joli des deux chevaux en tandem, l’aîné plaçait son dog-cart comme s’il eût voulu gagner une gageure. C’est ici qu’il fut extraordinaire. Il se surpassa, devint voyant. Il était avec eux et sa double-vue le mettait devant les chiens. Il devinait tout, les défauts, les hourvaris, les changes, et il les résolvait. Si juste qu’en tournant soudain au grand trot, il vit au loin passer le daguet sur ses fins traînant la jambe, tandis que le tonnerre de la meute approchait. Ils débouchèrent, Jacques au cul des chiens. Jacques cria d’orgueil et de contentement, l’aîné était vraiment incomparable. « Bravo, Père ! » hurla le cadet en fonçant encore, tandis que son frère avait fort à faire pour empêcher son attelage de prendre le mors aux dents. Le cheval de tête faisait seul quelques foulées de galop, mais la voiture volait, justement lancée sur une allée de rendez-vous qui permettait la vitesse, entrainant tout le monde vers le rond-point…
Hallali !
Quand le daguet fit tête, la voiture arrivait, et tout autour des chiens, le cadet ne tenait plus en place appelant son frère : « A toi de servir, tu l’as rudement mérité ! » cria-t-il. Alors sautant à terre, prenant le couteau lui aussi aux lanternes, l’homme de la voiture s’approcha, se pencha, frappa. Ils firent curée chaude « car de vrai, les chiens y avaient droit, hein Père, et vous n’eussiez pas admis qu’on leur ravît leur dû avec la cérémonie, et ils étaient si sages en attendant derrière les fouets croisés… ». D’ailleurs, le père pouvait tout voir, on était entre gens de qualité. Ce courre, si brusque et si vif, n’avait réuni que des hommes de la forêt, de la serpe ou de la hache, du vrai monde et des gars à sabots à qui l’on peut faire confiance. On dit aux coupeurs de bois : « c’est notre père que nous ramenions à la maison, et qui vient de faire sa dernière menée… ». Et tous ces rudes cœurs avaient compris, sans plus. Les forestiers, casquette basse, saisissaient la beauté de la chose et son juste fondé. Le lourd cercueil s’étalait librement. On avait soulevé la banquette, et, sur la chasse, on déposa le couteau, la cape, la tutute d’argent que l’aîné avait retiré de son col. Alors, ils achevèrent ce qu’ils réservaient pour la fin, et qui selon leur code et leur scrupule, devait tout faire absoudre, rendre à leur acte sa solennité et son grandiose. Ils firent au cercueil les « Honneurs du pied ». Le cadet entrelaça d’une main un peu tremblante la peau de réserve qui sert à suspendre le débris, et la larme à l’œil, tirant la bouche, il remplaça le piqueux, qui, à l’ordinaire apporte et présente. « Tenez, père, fit-il en mettant un genou sur le fond de la voiture, tandis que son pied gauche restait encore sur le marchepied, tenez, reprit-il, en accrochant le pied sur le chêne brut, voilà pour le dernier cerf que vous avez forcé ! ». Alors, dans le rond-point éclatant sous la lumière hivernale au centre des huit allées, les deux fils et les deux piqueurs sonnèrent éperdument « Aux Honneurs ». Ils les entremêlaient de leur fanfare de modestes veneurs, mais qui savaient chasser. Derrière les planches du cercueil, tous voyaient une grande figure un peu massive qui, les yeux clos, souriait. Ils inhumèrent le père avec le pied sur la poitrine, et comme le cadet, pris de scrupule, demandait : « tout de même, c’est peut-être pas très bien, ce qu’on fait là ? », l’aîné répondit : « Allons donc, cela lui aurait fait tellement de plaisir ».
