- Alpes-Maritimes : le Tribunal de police de Nice a rendu, le 5 janvier 2026, sa décision dans une affaire de chasse illégale au chamois sur la commune de Venanson. Trois chasseurs étaient poursuivis pour des faits qualifiés d’organisés et répétés. L’enquête menée par l’OFB a établi l’abattage illégal d’un éterlou femelle âgé de moins d’un an lors d’une battue, avec l’usage prohibé d’un chien, en présence du président de la société de chasse et d’un garde particulier. Une seconde battue illégale constatée en octobre 2024 a confirmé l’organisation des infractions. L’affaire a été examinée à l’audience du 1er décembre 2025, l’Association Stéphane Lamart s’étant constituée partie civile. Par jugement, le tribunal a déclaré les trois prévenus coupables. Le chasseur rabatteur a été condamné à une amende de 300 euros et à une suspension du permis de chasser de trois mois. Le président de la société de chasse a écopé d’une amende de 500 euros, d’une suspension du permis d’un an et de la confiscation de la carabine utilisée. Le garde particulier a été condamné à une amende de 500 euros et à une suspension du permis de chasser de six mois. Sur le plan civil, les prévenus ont été condamnés à indemniser les préjudices moral et écologique reconnus par le tribunal.
- Ardèche : la préfecture a pris un arrêté autorisant un louvetier à réguler, jusqu’au 6 février, les populations de sangliers et de chevreuils sur la commune de Saint-Péray. Cette décision, demandée par le domaine viticole de Vichouere, vise à limiter les dégâts sur les parcelles agricoles, en particulier les vignes. Les chevreuils, dont la population locale semble se concentrer, causent des pertes importantes pour les viticulteurs. Guillaume Gilles, vigneron à Saint-Péray et Cornas, a ainsi constaté au printemps dernier des rameaux totalement endommagés, estimant ses pertes à plusieurs milliers d’euros. Avec deux autres domaines, les pertes sont évaluées à environ 15 000 euros. Ce dispositif permet au louvetier d’intervenir « par tout moyen autorisé par la réglementation » pour protéger les cultures. Pour les exploitants, il ne s’agit pas de supprimer la faune mais de maintenir un équilibre nécessaire face à des populations qui deviennent localement trop importantes.
Ardèche encore : même les routes semblent participer à la saison de la chasse. Le samedi 10 janvier, un chasseur de l’ACCA de Saint-Julien-le-Roux, engagé dans une battue au sanglier, a vécu une mésaventure pour le moins… piquante. Alors qu’il circulait tranquillement sur la RD 21, entre le hameau de Roissac et le col de Serre-Mure, son véhicule a soudainement rendu les armes : crevaison nette de la roue arrière droite. La cause ? Un bois de chevreuil solidement encastré en plein cœur du pneu.  Une rencontre inattendue entre caoutchouc et ramure, remportée sans appel par la nature. Les chevreuils perdant leurs bois en cette période, l’un d’eux avait visiblement décidé de se poster au bord de la chaussée, prêt à l’embuscade. Bilan chez le garagiste : pneu irréparable. Comme quoi, en hiver, certains trophées ne se ramassent pas sans risque…
Une rencontre inattendue entre caoutchouc et ramure, remportée sans appel par la nature. Les chevreuils perdant leurs bois en cette période, l’un d’eux avait visiblement décidé de se poster au bord de la chaussée, prêt à l’embuscade. Bilan chez le garagiste : pneu irréparable. Comme quoi, en hiver, certains trophées ne se ramassent pas sans risque…
- Aude : les zones humides du Narbonnais célèbrent en 2026 les 20 ans de leur reconnaissance internationale par le label Ramsar. Attribué en 2006 aux étangs du Narbonnais, ce label souligne l’importance majeure de ces milieux pour leur biodiversité remarquable, leurs paysages emblématiques et les activités humaines traditionnelles, comme la pêche lagunaire. Pour marquer cet anniversaire, le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée propose plusieurs temps forts ouverts au public, avec pour objectif de sensibiliser à la préservation de ces espaces naturels aussi riches que fragiles. Parmi eux, un concours photo est organisé du 3 au 25 janvier 2026. Ouvert à tous, il invite habitants et passionnés à poser leur regard sur les zones humides à travers quatre catégories : paysages, faune et flore, activités humaines et jeunes de moins de 18 ans. Les clichés seront examinés par un jury de photographes et de scientifiques. Chaque lauréat remportera un panier garni d’une valeur de 80 euros. Les résultats seront dévoilés le 6 février 2026 lors d’une soirée spéciale au Théâtre de Narbonne, mêlant projection de film et conférence scientifique, en écho à la Journée mondiale des zones humides célébrée chaque 2 février...
[ LIRE LA SUITE... ]
 Grâce à de minuscules balises embarquant plusieurs capteurs, les chercheurs ont suivi 17 espèces de petits oiseaux lors de la traversée de la mer Méditerranée, du golfe de Gascogne et du désert du Sahara. Résultat : au-dessus de la mer, les oiseaux volent bas, parfois à quelques dizaines de mètres au-dessus de l’eau. En revanche, au-dessus du Sahara, ils prennent de la hauteur : en moyenne 1 600 mètres la nuit et jusqu’à 2 800 mètres le jour. Pourquoi voler si haut dans le désert ? Principalement pour éviter la surchauffe. En altitude, l’air est plus frais et permet aux oiseaux de mieux supporter la chaleur extrême et le rayonnement solaire. L’étude confirme aussi que les espèces aux ailes larges montent plus facilement en altitude, tandis que celles au plumage plus foncé ou aux os d’ailes plus courts volent encore plus haut, probablement pour limiter l’absorption de chaleur. Ces résultats montrent que migration rime avec adaptation fine : chaque détail du corps de l’oiseau compte pour survivre à ces voyages extrêmes. Au-delà de la prouesse, cette recherche aide aussi à mieux comprendre comment le changement climatique pourrait affecter les routes migratoires à l’avenir.
Grâce à de minuscules balises embarquant plusieurs capteurs, les chercheurs ont suivi 17 espèces de petits oiseaux lors de la traversée de la mer Méditerranée, du golfe de Gascogne et du désert du Sahara. Résultat : au-dessus de la mer, les oiseaux volent bas, parfois à quelques dizaines de mètres au-dessus de l’eau. En revanche, au-dessus du Sahara, ils prennent de la hauteur : en moyenne 1 600 mètres la nuit et jusqu’à 2 800 mètres le jour. Pourquoi voler si haut dans le désert ? Principalement pour éviter la surchauffe. En altitude, l’air est plus frais et permet aux oiseaux de mieux supporter la chaleur extrême et le rayonnement solaire. L’étude confirme aussi que les espèces aux ailes larges montent plus facilement en altitude, tandis que celles au plumage plus foncé ou aux os d’ailes plus courts volent encore plus haut, probablement pour limiter l’absorption de chaleur. Ces résultats montrent que migration rime avec adaptation fine : chaque détail du corps de l’oiseau compte pour survivre à ces voyages extrêmes. Au-delà de la prouesse, cette recherche aide aussi à mieux comprendre comment le changement climatique pourrait affecter les routes migratoires à l’avenir.




 Ces deux textes doivent maintenant recevoir le consentement des eurodéputés dans le cadre du processus de ratification européen. C’est précisément à ce stade que le Parlement européen peut encore bloquer l’accord. Les traités de l’UE requièrent l’approbation du Parlement pour que des accords commerciaux puissent être conclus par l’Union. Sans ce vote positif, l’accord ne peut pas être ratifié et ne peut donc pas entrer en vigueur de manière définitive. Plusieurs eurodéputés s’opposent à l’accord, notamment en raison de préoccupations liées à l’agriculture, à l’environnement et à la souveraineté législative de l’UE. Un point de tension porte sur un mécanisme de « rééquilibrage » intégré au texte, qui permettrait aux pays du Mercosur de demander des compensations si des législations européennes futures réduisaient leurs exportations vers l’UE. Certains parlementaires estiment que ce mécanisme pourrait contourner des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne. En conséquence, un projet de résolution a été déposé par des députés verts et de gauche demandant au Parlement de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour obtenir un avis juridique sur la compatibilité de cet accord avec les traités européens avant de procéder à un vote de consentement. Si cette résolution est adoptée, cela pourrait mener à une suspension du processus de ratification le temps que la CJUE émette son avis, ce qui retarderait notablement l’entrée en vigueur de l’accord. Dans ce contexte, l’opposition ne se limite pas à une simple résistance politique : elle s’appuie sur des arguments juridiques, environnementaux et économiques qui pourraient influencer le vote des eurodéputés au printemps 2026. Un rejet du Parlement ou une décision défavorable de la CJUE rendrait nécessaire une renégociation du texte ou des ajustements substantiels, rallongeant encore le long chemin vers la mise en œuvre de ce traité commercial majeur.
Ces deux textes doivent maintenant recevoir le consentement des eurodéputés dans le cadre du processus de ratification européen. C’est précisément à ce stade que le Parlement européen peut encore bloquer l’accord. Les traités de l’UE requièrent l’approbation du Parlement pour que des accords commerciaux puissent être conclus par l’Union. Sans ce vote positif, l’accord ne peut pas être ratifié et ne peut donc pas entrer en vigueur de manière définitive. Plusieurs eurodéputés s’opposent à l’accord, notamment en raison de préoccupations liées à l’agriculture, à l’environnement et à la souveraineté législative de l’UE. Un point de tension porte sur un mécanisme de « rééquilibrage » intégré au texte, qui permettrait aux pays du Mercosur de demander des compensations si des législations européennes futures réduisaient leurs exportations vers l’UE. Certains parlementaires estiment que ce mécanisme pourrait contourner des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne. En conséquence, un projet de résolution a été déposé par des députés verts et de gauche demandant au Parlement de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour obtenir un avis juridique sur la compatibilité de cet accord avec les traités européens avant de procéder à un vote de consentement. Si cette résolution est adoptée, cela pourrait mener à une suspension du processus de ratification le temps que la CJUE émette son avis, ce qui retarderait notablement l’entrée en vigueur de l’accord. Dans ce contexte, l’opposition ne se limite pas à une simple résistance politique : elle s’appuie sur des arguments juridiques, environnementaux et économiques qui pourraient influencer le vote des eurodéputés au printemps 2026. Un rejet du Parlement ou une décision défavorable de la CJUE rendrait nécessaire une renégociation du texte ou des ajustements substantiels, rallongeant encore le long chemin vers la mise en œuvre de ce traité commercial majeur. Les données mensuelles montrent que tous les mois de 2025, à l’exception de février et décembre, ont été plus chauds que n’importe quel mois équivalent avant 2023, avec janvier 2025 enregistrant des records historiques. Ces résultats sont corroborés par les scientifiques de Berkeley Earth, qui observent une accélération du réchauffement entre 2023 et 2025, suggérant une intensification du changement climatique d’origine humaine, principalement due aux émissions continues de gaz à effet de serre issues de la combustion de charbon, pétrole et gaz. Face à ces constats, les climatologues anticipent que 2026 figurera parmi les cinq années les plus chaudes jamais mesurées, et pourrait même rivaliser avec 2025 en termes de température moyenne annuelle. Comme le souligne Samantha Burgess, directrice adjointe du service climat de Copernicus, la trajectoire est « très, très claire » et pourrait être encore accentuée si le phénomène El Niño, connu pour son effet réchauffant, venait à se manifester. D’autres facteurs influencent également ce réchauffement. Paradoxalement, la réduction mondiale des émissions de dioxydes de soufre des navires depuis 2020, bénéfique pour la qualité de l’air, a atténué l’effet refroidissant des aérosols atmosphériques, augmentant légèrement l’impact du réchauffement global. Carlo Buontempo, directeur du service changement climatique de Copernicus, reconnaît que le dépassement du seuil de +1,5 °C est désormais inévitable, et que le véritable enjeu est de déterminer comment gérer au mieux ses conséquences sur les sociétés humaines et les écosystèmes naturels. Copernicus estime désormais probable que le réchauffement durable au-delà de +1,5 °C soit officiellement confirmé d’ici la fin de cette décennie, soit plus d’une décennie plus tôt que prévu.
Les données mensuelles montrent que tous les mois de 2025, à l’exception de février et décembre, ont été plus chauds que n’importe quel mois équivalent avant 2023, avec janvier 2025 enregistrant des records historiques. Ces résultats sont corroborés par les scientifiques de Berkeley Earth, qui observent une accélération du réchauffement entre 2023 et 2025, suggérant une intensification du changement climatique d’origine humaine, principalement due aux émissions continues de gaz à effet de serre issues de la combustion de charbon, pétrole et gaz. Face à ces constats, les climatologues anticipent que 2026 figurera parmi les cinq années les plus chaudes jamais mesurées, et pourrait même rivaliser avec 2025 en termes de température moyenne annuelle. Comme le souligne Samantha Burgess, directrice adjointe du service climat de Copernicus, la trajectoire est « très, très claire » et pourrait être encore accentuée si le phénomène El Niño, connu pour son effet réchauffant, venait à se manifester. D’autres facteurs influencent également ce réchauffement. Paradoxalement, la réduction mondiale des émissions de dioxydes de soufre des navires depuis 2020, bénéfique pour la qualité de l’air, a atténué l’effet refroidissant des aérosols atmosphériques, augmentant légèrement l’impact du réchauffement global. Carlo Buontempo, directeur du service changement climatique de Copernicus, reconnaît que le dépassement du seuil de +1,5 °C est désormais inévitable, et que le véritable enjeu est de déterminer comment gérer au mieux ses conséquences sur les sociétés humaines et les écosystèmes naturels. Copernicus estime désormais probable que le réchauffement durable au-delà de +1,5 °C soit officiellement confirmé d’ici la fin de cette décennie, soit plus d’une décennie plus tôt que prévu. Une rencontre inattendue entre caoutchouc et ramure, remportée sans appel par la nature. Les chevreuils perdant leurs bois en cette période, l’un d’eux avait visiblement décidé de se poster au bord de la chaussée, prêt à l’embuscade. Bilan chez le garagiste : pneu irréparable. Comme quoi, en hiver, certains trophées ne se ramassent pas sans risque…
Une rencontre inattendue entre caoutchouc et ramure, remportée sans appel par la nature. Les chevreuils perdant leurs bois en cette période, l’un d’eux avait visiblement décidé de se poster au bord de la chaussée, prêt à l’embuscade. Bilan chez le garagiste : pneu irréparable. Comme quoi, en hiver, certains trophées ne se ramassent pas sans risque…  En Amazonie comme dans le Cerrado, la déforestation progresse d’abord pour une raison simple : créer des pâturages et des surfaces agricoles destinées à l’exportation. Chaque tonne de viande sud-américaine consommée en Europe est potentiellement issue d’hectares de forêts rasés, brûlés, anéantis. L’hypocrisie est totale. D’un côté, Bruxelles explique vouloir interdire les produits liés à la déforestation, de l’autre, elle signe un accord qui rendra ces mêmes produits plus compétitifs sur le marché européen. Comment croire à une politique environnementale crédible quand les décisions commerciales contredisent frontalement les objectifs affichés ? Le cynisme atteint son sommet lorsque l’on comprend la logique économique sous-jacente. En échange de ces concessions agricoles majeures, l’Europe espère vendre davantage de voitures, notamment allemandes, sur les marchés sud-américains. Autrement dit, on sacrifie des forêts millénaires, des écosystèmes uniques et le climat mondial pour quelques parts de marché supplémentaires dans l’automobile. Pour quelques roues de plus sous des berlines, on marche sur la tête. Ce choix est aussi une trahison envers les agriculteurs européens. On leur impose des règles environnementales strictes, des coûts de production élevés, des contrôles permanents, tout en les mettant en concurrence avec des filières qui ne respectent ni les mêmes normes sanitaires, ni les mêmes exigences sociales, ni les mêmes contraintes écologiques. C’est une concurrence déloyale institutionnalisée, assumée, organisée. L’Europe doit choisir. Soit elle fait de la biodiversité, du climat et de la cohérence écologique une priorité réelle, soit elle continue à empiler des discours vertueux sur des accords commerciaux destructeurs. On ne peut pas, durablement, défendre la planète d’une main et la vendre de l’autre. Le Mercosur n’est pas un détail technique : c’est un révélateur brutal de l’incohérence européenne.
En Amazonie comme dans le Cerrado, la déforestation progresse d’abord pour une raison simple : créer des pâturages et des surfaces agricoles destinées à l’exportation. Chaque tonne de viande sud-américaine consommée en Europe est potentiellement issue d’hectares de forêts rasés, brûlés, anéantis. L’hypocrisie est totale. D’un côté, Bruxelles explique vouloir interdire les produits liés à la déforestation, de l’autre, elle signe un accord qui rendra ces mêmes produits plus compétitifs sur le marché européen. Comment croire à une politique environnementale crédible quand les décisions commerciales contredisent frontalement les objectifs affichés ? Le cynisme atteint son sommet lorsque l’on comprend la logique économique sous-jacente. En échange de ces concessions agricoles majeures, l’Europe espère vendre davantage de voitures, notamment allemandes, sur les marchés sud-américains. Autrement dit, on sacrifie des forêts millénaires, des écosystèmes uniques et le climat mondial pour quelques parts de marché supplémentaires dans l’automobile. Pour quelques roues de plus sous des berlines, on marche sur la tête. Ce choix est aussi une trahison envers les agriculteurs européens. On leur impose des règles environnementales strictes, des coûts de production élevés, des contrôles permanents, tout en les mettant en concurrence avec des filières qui ne respectent ni les mêmes normes sanitaires, ni les mêmes exigences sociales, ni les mêmes contraintes écologiques. C’est une concurrence déloyale institutionnalisée, assumée, organisée. L’Europe doit choisir. Soit elle fait de la biodiversité, du climat et de la cohérence écologique une priorité réelle, soit elle continue à empiler des discours vertueux sur des accords commerciaux destructeurs. On ne peut pas, durablement, défendre la planète d’une main et la vendre de l’autre. Le Mercosur n’est pas un détail technique : c’est un révélateur brutal de l’incohérence européenne. Sur le plan chimique, le pétrichor est principalement attribué à la présence de composés organiques volatils, dont la géosmine et le 2 méthylisobornéol (2 MIB), des molécules produites par des micro organismes du sol, en particulier les actinobactéries. À ces composés s’ajoutent des huiles végétales hydrophobes sécrétées par certaines plantes et accumulées à la surface des sols et des roches durant les périodes sèches, contribuant à la complexité du bouquet olfactif. Les actinobactéries jouent un rôle central dans la genèse biologique du pétrichor. En conditions de stress hydrique, ces micro organismes produisent des spores contenant de la géosmine, lesquelles s’accumulent dans les couches superficielles du sol. L’arrivée de la pluie provoque leur remise en suspension et leur dispersion dans l’air. Cette libération soudaine suggère une fonction écologique potentielle, notamment en facilitant la dissémination des spores ou en agissant comme signal chimique pour certains organismes du sol ou insectes. Le mécanisme de transfert des composés odorants vers l’atmosphère repose sur un processus physique d’aérosolisation. Lorsque les gouttes de pluie impactent un sol sec et poreux, elles emprisonnent de fines bulles d’air qui remontent rapidement à la surface et éclatent. Ce phénomène projette dans l’air des micro aérosols chargés de composés organiques et microbiens. L’intensité du pétrichor dépend ainsi de plusieurs paramètres, tels que la taille et la vitesse des gouttes de pluie, la porosité et la composition du sol, ainsi que les conditions atmosphériques locales. Au delà de l’expérience sensorielle humaine, le pétrichor présente des enjeux scientifiques et écologiques notables. Il constitue un indicateur des échanges entre le sol et l’atmosphère et offre un modèle pertinent pour l’étude des aérosols naturels. Ses applications potentielles concernent des domaines variés, allant de l’agronomie à la qualité de l’air, en passant par la parfumerie. Ainsi, le pétrichor illustre la complexité des interactions invisibles reliant les processus biologiques, chimiques et physiques au sein des environnements terrestres.
Sur le plan chimique, le pétrichor est principalement attribué à la présence de composés organiques volatils, dont la géosmine et le 2 méthylisobornéol (2 MIB), des molécules produites par des micro organismes du sol, en particulier les actinobactéries. À ces composés s’ajoutent des huiles végétales hydrophobes sécrétées par certaines plantes et accumulées à la surface des sols et des roches durant les périodes sèches, contribuant à la complexité du bouquet olfactif. Les actinobactéries jouent un rôle central dans la genèse biologique du pétrichor. En conditions de stress hydrique, ces micro organismes produisent des spores contenant de la géosmine, lesquelles s’accumulent dans les couches superficielles du sol. L’arrivée de la pluie provoque leur remise en suspension et leur dispersion dans l’air. Cette libération soudaine suggère une fonction écologique potentielle, notamment en facilitant la dissémination des spores ou en agissant comme signal chimique pour certains organismes du sol ou insectes. Le mécanisme de transfert des composés odorants vers l’atmosphère repose sur un processus physique d’aérosolisation. Lorsque les gouttes de pluie impactent un sol sec et poreux, elles emprisonnent de fines bulles d’air qui remontent rapidement à la surface et éclatent. Ce phénomène projette dans l’air des micro aérosols chargés de composés organiques et microbiens. L’intensité du pétrichor dépend ainsi de plusieurs paramètres, tels que la taille et la vitesse des gouttes de pluie, la porosité et la composition du sol, ainsi que les conditions atmosphériques locales. Au delà de l’expérience sensorielle humaine, le pétrichor présente des enjeux scientifiques et écologiques notables. Il constitue un indicateur des échanges entre le sol et l’atmosphère et offre un modèle pertinent pour l’étude des aérosols naturels. Ses applications potentielles concernent des domaines variés, allant de l’agronomie à la qualité de l’air, en passant par la parfumerie. Ainsi, le pétrichor illustre la complexité des interactions invisibles reliant les processus biologiques, chimiques et physiques au sein des environnements terrestres. Patrick Sébastien affirme vouloir donner une voix à ce qu’il décrit comme « une France oubliée », éloignée des cercles de décision et des formations politiques traditionnelles. Le mouvement repose sur un site internet permettant aux citoyens de transmettre leurs propositions, parfois de manière anonyme, sur des sujets variés tels que le pouvoir d’achat, les services publics, la sécurité ou encore la justice sociale. L’objectif affiché est de recueillir des idées concrètes et applicables, puis d’en faire une synthèse. Le fonctionnement de « Ça suffit » repose sur une stratégie assumée d’influence plutôt que de conquête du pouvoir. Patrick Sébastien a exclu à plusieurs reprises toute candidature personnelle à une élection. Il se définit comme un porte-voix, utilisant sa notoriété pour relayer des revendications citoyennes auprès des responsables politiques. L’une des ambitions du mouvement serait de peser sur le second tour de la présidentielle en présentant aux finalistes une liste de propositions issues de la plateforme, et en appelant les électeurs à soutenir le candidat qui s’engagerait à les reprendre. Cette démarche, que l’intéressé qualifie parfois de « chantage démocratique », suscite des réactions contrastées. Certains y voient une tentative originale de revitalisation de la participation citoyenne, dans un contexte de défiance envers les partis et les institutions. D’autres dénoncent une initiative floue, portée par une figure médiatique sans cadre politique structuré ni légitimité élective. Patrick Sébastien assume ce positionnement atypique, insistant sur le caractère indépendant du mouvement. « Ça suffit » ne revendique aucune affiliation partisane et ne présente pas de programme clé en main. Il s’agit, selon son promoteur, d’un outil de pression citoyenne plus que d’un projet de gouvernement.
Patrick Sébastien affirme vouloir donner une voix à ce qu’il décrit comme « une France oubliée », éloignée des cercles de décision et des formations politiques traditionnelles. Le mouvement repose sur un site internet permettant aux citoyens de transmettre leurs propositions, parfois de manière anonyme, sur des sujets variés tels que le pouvoir d’achat, les services publics, la sécurité ou encore la justice sociale. L’objectif affiché est de recueillir des idées concrètes et applicables, puis d’en faire une synthèse. Le fonctionnement de « Ça suffit » repose sur une stratégie assumée d’influence plutôt que de conquête du pouvoir. Patrick Sébastien a exclu à plusieurs reprises toute candidature personnelle à une élection. Il se définit comme un porte-voix, utilisant sa notoriété pour relayer des revendications citoyennes auprès des responsables politiques. L’une des ambitions du mouvement serait de peser sur le second tour de la présidentielle en présentant aux finalistes une liste de propositions issues de la plateforme, et en appelant les électeurs à soutenir le candidat qui s’engagerait à les reprendre. Cette démarche, que l’intéressé qualifie parfois de « chantage démocratique », suscite des réactions contrastées. Certains y voient une tentative originale de revitalisation de la participation citoyenne, dans un contexte de défiance envers les partis et les institutions. D’autres dénoncent une initiative floue, portée par une figure médiatique sans cadre politique structuré ni légitimité élective. Patrick Sébastien assume ce positionnement atypique, insistant sur le caractère indépendant du mouvement. « Ça suffit » ne revendique aucune affiliation partisane et ne présente pas de programme clé en main. Il s’agit, selon son promoteur, d’un outil de pression citoyenne plus que d’un projet de gouvernement. Or, cette dimension temporelle, indispensable à l’analyse scientifique du vivant, est aujourd’hui fragilisée par une érosion des financements, une remise en cause croissante de l’expertise scientifique et la diffusion de discours de désinformation qui brouillent le débat public. Les pressions anthropiques sur les systèmes naturels (changement climatique, artificialisation des sols, pollutions, surexploitation des ressourc
Or, cette dimension temporelle, indispensable à l’analyse scientifique du vivant, est aujourd’hui fragilisée par une érosion des financements, une remise en cause croissante de l’expertise scientifique et la diffusion de discours de désinformation qui brouillent le débat public. Les pressions anthropiques sur les systèmes naturels (changement climatique, artificialisation des sols, pollutions, surexploitation des ressourc es biologiques) entraînent une accélération inédite de l’érosion de la biodiversité. Dans ce contexte, les « signaux faibles » détectés par les chercheurs deviennent rapidement des indicateurs d’alerte, annonçant des ruptures écologiques majeures aux conséquences systémiques pour le fonctionnement des écosystèmes et les sociétés humaines. Seules les recherches écologiques à long terme permettent d’identifier les trajectoires réelles de la biodiversité, de distinguer les fluctuations naturelles des tendances de fond et d’évaluer les capacités d’adaptation des espèces face aux perturbations globales. Dans un article publié dans la revue BioScience, le CNRS alerte sur les conséquences de cette fragilisation : sans infrastructures pérennes d’observation du vivant, la communauté scientifique perdra sa capacité à anticiper les points de bascule écologiques et à proposer des réponses fondées sur des données robustes. Pour répondre à cet enjeu, le CNRS a lancé le programme SEE-Life, dédié au soutien de la recherche écologique et évolutive à long terme. Ce programme vise à garantir la continuité des suivis, à renforcer l’interdisciplinarité et à produire des connaissances directement mobilisables par les politiques publiques.
es biologiques) entraînent une accélération inédite de l’érosion de la biodiversité. Dans ce contexte, les « signaux faibles » détectés par les chercheurs deviennent rapidement des indicateurs d’alerte, annonçant des ruptures écologiques majeures aux conséquences systémiques pour le fonctionnement des écosystèmes et les sociétés humaines. Seules les recherches écologiques à long terme permettent d’identifier les trajectoires réelles de la biodiversité, de distinguer les fluctuations naturelles des tendances de fond et d’évaluer les capacités d’adaptation des espèces face aux perturbations globales. Dans un article publié dans la revue BioScience, le CNRS alerte sur les conséquences de cette fragilisation : sans infrastructures pérennes d’observation du vivant, la communauté scientifique perdra sa capacité à anticiper les points de bascule écologiques et à proposer des réponses fondées sur des données robustes. Pour répondre à cet enjeu, le CNRS a lancé le programme SEE-Life, dédié au soutien de la recherche écologique et évolutive à long terme. Ce programme vise à garantir la continuité des suivis, à renforcer l’interdisciplinarité et à produire des connaissances directement mobilisables par les politiques publiques. Une partie de ces terrains est exploitée par des agriculteurs dans le cadre de baux ruraux environnementaux, qui encadrent les pratiques agricoles afin de concilier production et protection des milieux naturels. Le partenariat avec la Fnab vise à renforcer cette orientation en accompagnant les exploitants vers des pratiques biologiques ou agroécologiques. Selon le communiqué commun, la Fnab apportera son expertise technique et son réseau pour soutenir les agriculteurs déjà installés sur les terres du Conservatoire, mais aussi ceux susceptibles de s’y installer. L’accompagnement portera notamment sur l’évolution des systèmes de production, la conversion à l’agriculture biologique et la valorisation économique de pratiques jugées favorables à la biodiversité et au climat. L’objectif affiché est de sécuriser les parcours de transition, dans un contexte où la conversion au bio peut représenter un risque économique pour les exploitations. Le partenariat prévoit également de mieux valoriser les modèles agricoles déjà en place sur les sites du Conservatoire du littoral. Ces territoires accueillent majoritairement de l’élevage extensif et des cultures à faible intrant, considérés comme compatibles avec la préservation des sols, des zones humides et des espèces protégées.
Une partie de ces terrains est exploitée par des agriculteurs dans le cadre de baux ruraux environnementaux, qui encadrent les pratiques agricoles afin de concilier production et protection des milieux naturels. Le partenariat avec la Fnab vise à renforcer cette orientation en accompagnant les exploitants vers des pratiques biologiques ou agroécologiques. Selon le communiqué commun, la Fnab apportera son expertise technique et son réseau pour soutenir les agriculteurs déjà installés sur les terres du Conservatoire, mais aussi ceux susceptibles de s’y installer. L’accompagnement portera notamment sur l’évolution des systèmes de production, la conversion à l’agriculture biologique et la valorisation économique de pratiques jugées favorables à la biodiversité et au climat. L’objectif affiché est de sécuriser les parcours de transition, dans un contexte où la conversion au bio peut représenter un risque économique pour les exploitations. Le partenariat prévoit également de mieux valoriser les modèles agricoles déjà en place sur les sites du Conservatoire du littoral. Ces territoires accueillent majoritairement de l’élevage extensif et des cultures à faible intrant, considérés comme compatibles avec la préservation des sols, des zones humides et des espèces protégées. Objectif affiché : contrôler ce qui entre sur le territoire. « Ils contrôlent ce qui sort, nous contrôlons ce qui rentre », résume Tom Gremont, éleveur à Dieppe. À l’aide de disqueuses, plusieurs remorques ont été ouvertes. Verdict répété à plusieurs reprises : « la viande n’est pas française ». Derrière le geste symbolique, l’argument est avant tout économique. Selon les organisations agricoles, le coût de production d’un kilo de viande bovine en France dépasse souvent 5 à 6 euros, contre 2 à 3 euros dans certains pays d’Amérique du Sud. En cause : des salaires et des charges sociales élevées, des normes sanitaires et environnementales strictes. À l’inverse, les producteurs étrangers bénéficient de coûts salariaux bien plus faibles et de réglementations moins contraignantes, leur permettant d’exporter à des prix imbattables. Les agriculteurs dénoncent aussi un risque de pression à la baisse sur les prix payés aux producteurs français, déjà fragilisés par la hausse des charges énergétiques et des intrants. À la mi-journée lundi, une quinzaine de camions avaient été contrôlés, sans incident avec les forces de l’ordre, restées en observation. Les actions pourraient se poursuivre, les agriculteurs affirmant ne pas être prêts à lever les barrages tant que leurs revendications économiques et financières ne seront pas entendues.
Objectif affiché : contrôler ce qui entre sur le territoire. « Ils contrôlent ce qui sort, nous contrôlons ce qui rentre », résume Tom Gremont, éleveur à Dieppe. À l’aide de disqueuses, plusieurs remorques ont été ouvertes. Verdict répété à plusieurs reprises : « la viande n’est pas française ». Derrière le geste symbolique, l’argument est avant tout économique. Selon les organisations agricoles, le coût de production d’un kilo de viande bovine en France dépasse souvent 5 à 6 euros, contre 2 à 3 euros dans certains pays d’Amérique du Sud. En cause : des salaires et des charges sociales élevées, des normes sanitaires et environnementales strictes. À l’inverse, les producteurs étrangers bénéficient de coûts salariaux bien plus faibles et de réglementations moins contraignantes, leur permettant d’exporter à des prix imbattables. Les agriculteurs dénoncent aussi un risque de pression à la baisse sur les prix payés aux producteurs français, déjà fragilisés par la hausse des charges énergétiques et des intrants. À la mi-journée lundi, une quinzaine de camions avaient été contrôlés, sans incident avec les forces de l’ordre, restées en observation. Les actions pourraient se poursuivre, les agriculteurs affirmant ne pas être prêts à lever les barrages tant que leurs revendications économiques et financières ne seront pas entendues.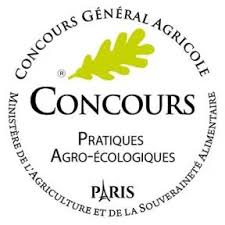 En 2020, le concours s’est élargi avec l’introduction d’une seconde catégorie dédiée à l’agroforesterie, afin de mieux refléter la diversité des pratiques agroécologiques mises en œuvre sur le terrain. Deux catégories structurent désormais le concours. La catégorie « Prairies & Parcours » distingue les pratiques de fauche et de pâturage sur des prairies naturelles à forte diversité floristique. Ces milieux produisent un fourrage de qualité, apprécié des animaux, et favorisent des produits agricoles reconnus pour leurs qualités gustatives. En intégrant arbres et haies, ces systèmes offrent également des habitats favorables à de nombreuses espèces animales. La catégorie « Agroforesterie » récompense quant à elle l’association de l’arbre à l’agriculture sous différentes formes : haies, bocages, prés-vergers, alignements d’arbres en grandes cultures ou en maraîchage. Ces pratiques limitent l’érosion, renforcent le stockage du carbone, améliorent le bien-être animal et peuvent constituer un complément de revenu pour les exploitations. L’organisation du concours repose sur deux niveaux de sélection. Au niveau local, des structures organisatrices compétentes (collectivités, chambres d’agriculture, parcs naturels, associations ou groupements d’intérêt économique et environnemental) accompagnent les agriculteurs candidats dans l’inscription et le choix des parcelles. Des jurys indépendants, réunissant des compétences variées (botanique, agronomie, entomologie, ornithologie…), évaluent ensuite les pratiques selon des grilles d’analyse spécifiques et désignent les lauréats locaux. Ces finalistes accèdent au niveau national, piloté par un comité d’orientation rassemblant notamment les chambres d’agriculture, l’INRAE, l’INAO, les ministères concernés, l’Office français de la biodiversité et les réseaux des parcs naturels. Les lauréats nationaux sont enfin récompensés lors d’une cérémonie officielle au Salon international de l’Agriculture, consacrant des pratiques agricoles exemplaires au service de la biodiversité et des territoires.
En 2020, le concours s’est élargi avec l’introduction d’une seconde catégorie dédiée à l’agroforesterie, afin de mieux refléter la diversité des pratiques agroécologiques mises en œuvre sur le terrain. Deux catégories structurent désormais le concours. La catégorie « Prairies & Parcours » distingue les pratiques de fauche et de pâturage sur des prairies naturelles à forte diversité floristique. Ces milieux produisent un fourrage de qualité, apprécié des animaux, et favorisent des produits agricoles reconnus pour leurs qualités gustatives. En intégrant arbres et haies, ces systèmes offrent également des habitats favorables à de nombreuses espèces animales. La catégorie « Agroforesterie » récompense quant à elle l’association de l’arbre à l’agriculture sous différentes formes : haies, bocages, prés-vergers, alignements d’arbres en grandes cultures ou en maraîchage. Ces pratiques limitent l’érosion, renforcent le stockage du carbone, améliorent le bien-être animal et peuvent constituer un complément de revenu pour les exploitations. L’organisation du concours repose sur deux niveaux de sélection. Au niveau local, des structures organisatrices compétentes (collectivités, chambres d’agriculture, parcs naturels, associations ou groupements d’intérêt économique et environnemental) accompagnent les agriculteurs candidats dans l’inscription et le choix des parcelles. Des jurys indépendants, réunissant des compétences variées (botanique, agronomie, entomologie, ornithologie…), évaluent ensuite les pratiques selon des grilles d’analyse spécifiques et désignent les lauréats locaux. Ces finalistes accèdent au niveau national, piloté par un comité d’orientation rassemblant notamment les chambres d’agriculture, l’INRAE, l’INAO, les ministères concernés, l’Office français de la biodiversité et les réseaux des parcs naturels. Les lauréats nationaux sont enfin récompensés lors d’une cérémonie officielle au Salon international de l’Agriculture, consacrant des pratiques agricoles exemplaires au service de la biodiversité et des territoires.